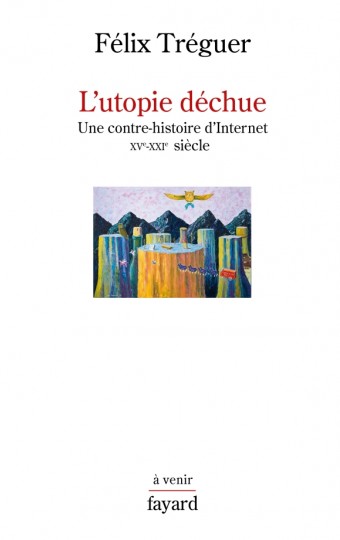AVANT-PROPOS : les articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » ne représentent pas les positions de notre tendance, mais sont publiés à titre d’information ou pour nourrir les débats d’actualités.
SOURCE : Bastamag

Une application smartphone de « tracking », c’est-à-dire de pistage des contaminations par le virus, serait-elle la solution pour sortir au plus vite du confinement ? Pas du tout, répond le sociologue et activiste des libertés numériques Félix Tréguer. Pour lui, ce n’est pas là que se trouve la réponse à la crise sanitaire. Surtout, sous l’apparence inoffensive du numérique, ces outils renforcent en fait le pouvoir policier.
Basta ! : À la Quadrature du net, une association dédiée à la défense des libertés à l’ère numérique, vous êtes radicalement opposés au projet d’application numérique de suivi du coronavirus. Pourquoi ?
Félix Tréguer [1] : L’idée de ce type d’application contre le virus est apparue fin mars comme la seule solution possible compte tenu de la casse de l’hôpital public, et de l’impréparation générale des autorités sanitaires. Il y a eu l’exemple de la Chine, puis de Singapour, qui a développé une version qui avait l’air moins problématique du point de vue de la vie privée. Aujourd’hui, une équipe de chercheurs européens, avec l’initiative PEPP-PT [pour « Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing »], promet de faire une version européenne de l’application en nous jurant que ce sera protecteur de la vie privée. En France, je trouve effarant de voir à quel point le débat se concentre sur cette application. Cela révèle le fait qu’il n’y a sans doute pas d’autre plan pour envisager le déconfinement du côté du gouvernement. Or, cette focalisation élude d’autres débats, d’autres manières d’aborder et de gérer cette crise plus collectivement.
Quels sont les dangers d’une telle application ?
Déjà, son efficacité est tout à fait douteuse. De ce qui est connu aujourd’hui du virus, de nombreux de cas de transmissions ne pourront jamais être documentés par une application de ce type. La version envisagée par l’initiative européenne retracerait la proximité entre deux personnes via Bluetooth. Il y a déjà des questions techniques sur la capacité de Bluetooth à faire cela, avec les faux positifs que cela peut générer, comme des voisins qui vivent dans des appartement mitoyens [séparés par un mur mais que l’application considérera comme « en contact », ndlr].
Puis, il y a les faux négatifs, puisque le virus se dépose sur des surfaces. Si je mets mes mains contaminées sur du mobilier public et qu’une personne, quelques heures plus tard, se trouve aussi au contact avec ces surfaces, c’est une modalité de transmission dont ces applications ne peuvent pas rendre compte. Ces doutes sur l’efficacité se matérialisent à Singapour. Après avoir expérimenté cette application, les autorités locales ont finalement décidé elles aussi d’un confinement généralisé. Peut-être aussi qu’un nombre insuffisant de personnes l’utilisaient.
Pour que cela ait la moindre chance de marcher, il faut que presque tout le monde l’utilise, à tel point qu’une telle application ne restera sûrement pas facultative très longtemps. Il faudrait aussi que les personnes identifiées comme potentiellement contaminées soient immédiatement placées en quarantaine stricte. À Hong-Kong, les personnes en quarantaine doivent porter des bracelets électroniques. En Pologne, elles ont l’obligation d’envoyer aux autorités des selfies depuis chez elles…
Sur le plan technique, pourquoi le fait de passer par Bluetooth serait-il moins attentatoire à la vie privée que la géolocalisation ?
En Chine, les applications comme Wechat [application de messagerie] ou Alipay [une solution de paiement] ont ajouté des fonctionnalités qui permettent aux Chinois d’envoyer aux autorités des rapports de santé et un journal de leurs géolocalisations enregistrées. En Israël aussi, les autorités détiennent aujourd’hui un journal de déplacements des habitants. Avec Bluetooth, elles sauraient seulement à côté de qui nous nous sommes trouvés, à partir du moment où une de ces personnes a été déclarée positive au coronavirus. C’est donc moins problématique, mais ne restera sans doute pas aussi bénin que cela a en a l’air.
En quoi des outils technologiques comme envoyer des selfies de chez soi ou un journal de géolocalisation seraient plus dissuasifs que, par exemple, des amendes pour non respect de confinement ou de la quarantaine ?
L’enjeu pour le pouvoir, c’est d’avoir l’air le moins contraignant possible. Cela se présente sous les dorures de la « start-up nation » comme quelque chose d’inoffensif et de volontaire. En fait, on voit bien que ces solutions technologiques s’articulent à des dispositifs de pouvoir sans doute très coercitifs. Ce n’est pas nouveau, les liens entre santé et contrôle des populations sont très anciens. Du temps des épidémies de peste, les mesures de lutte contre la contamination prenaient la forme d’interventions militaires et de cordons sanitaires – les individus qui les franchissaient étaient abattus. Désormais, les appareils numériques semblent, au moins pour une partie d’entre nous, rendre cette coercition plus douce.
Les multinationales du numérique et de la donnée sont aussi sur le coup, avec notamment Apple et Google qui annoncent une application de tracking du virus. Que peut-on attendre d’elles dans cette crise ?
On assiste à une opération de blanchiment numérique massive de nombreux acteurs qui incarnent le capitalisme de surveillance et son modèle économique basé sur la collecte généralisée de nos données personnelles, à travers les applications et tous les services numériques que nous utilisons. Je fais référence à la fois aux opérateurs de télécom qui mesurent les déplacements de la population, mais aussi à des start-ups qui vivent de la publicité ciblée, et à Google qui détient l’historique de navigation de centaines de millions d’utilisateurs de Google maps. Pour ces acteurs, notamment les Gafam qui étaient sous le feu des critiques depuis quelques mois, c’est une aubaine. Nombre d’acteurs estiment qu’il est très utile de disposer de ces masses de données sur la population pour la gérer aux mieux.
On voit aussi l’accélération de ces nouveaux paradigmes bureaucratiques et gestionnaires que sont ceux du big data dans le secteur de la santé. Palantir [firme états-unienne spécialisée dans l’analyse de données, créée avec l’aide de la CIA], Google, Microsoft, Amazon, cherchent à collaborer avec le service national de santé (NHS) du Royaume Uni. Ils sont aussi apparemment en discussion avec d’autres autorités sanitaires en Europe pour croiser des donnés et gérer de cette manière au mieux la ressource hospitalière. Puisqu’il n’y a pas assez de lits ni de matériel, on croise des tonnes de données pour essayer de piloter cela du mieux possible. Cette fuite en avant vers le big data participe à accélérer des transformations qui étaient déjà très prégnantes dans les politiques de santé, de réduction des moyens. Ce n’est pas de nature à créer un système de santé qui permettra de gérer ce type de crise sanitaire à l’avenir.
Selon vous, dans cet épisode, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), ne joue pas son rôle de garante des libertés numériques ?
La Cnil appelle certes à la vigilance mais, en fait, elle accompagne tranquillement le processus de surveillance, et conserve une vision très juridique, étriquée, rendue encore plus molle que d’habitude par la sidération ambiante. En retraçant son histoire, il apparaît que la Cnil fonctionne en fait beaucoup plus comme un alibi de la surveillance que comme une autorité capable de nous prémunir contre de telles dérives. Marie-Laure Denis, l’actuelle directrice de la Cnil, dans une interview au Monde, a dit au sujet des applications de backtracking du virus qu’il faudra un dispositif législatif si l’application est rendue obligatoire [2]. Ce que nous craignons, c’est que si une loi est votée un jour, elle donnera aussi tout pouvoir pour imposer des bracelets électroniques et des objets connectés aux personnes en quarantaine, pour s’assurer qu’elles restent bien chez elle, pour contrôler notre assignation à résidence. Cette position de la Cnil n’est pas du tout à la hauteur des enjeux.
Il y a aujourd’hui un débat autour de la tension entre surveillance numérique et libertés. Ce qui pourrait aiguiser aussi l’esprit critique sur la question des données personnelles et de leur utilisation massive y compris en temps normal, par les Facebook, Google, Apple…
Voir ainsi la majorité parlementaire se fracturer sur la question des applications de tracking traduit des formes de résistances. Globalement, beaucoup de gens pointent l’échec des politiques néolibérales dans le secteur de la santé. Le solutionnisme technologique mis en avant par les autorités sert à faire diversion sur cet échec. Tout le monde peut aussi faire l’expérience d’un gouvernement techno-policier massif, avec l’espace public contrôlé par la police de manière très dense, avec un déploiement massif des drones, qui étaient des engins peu utilisés jusqu’à présent, principalement pour surveiller les manifestations.
Avec le confinement, les drones sont utilisés dans un cadre juridique très flou, pour contrôler, verbaliser et surveiller la population. La reconnaissance faciale risque aussi de ressortir légitimée, parce que contrôler et identifier les gens autrement que par des papiers d’identité plein de traces de doigts et de miasmes, cela paraîtra plus hygiénique. Ce sont des arguments déjà formulés par la police aux frontières des États-Unis.
En France, des acteurs de la « technopolice », contre laquelle nous menons campagne [3] se présentent aujourd’hui comme étant en mesure d’offrir aux autorités des solutions hi-tech pour gérer aux mieux cette période trouble. Pour ne donner qu’un exemple, une petite start-up à Metz, qui s’appelle Two-I, expérimentait la reconnaissance faciale en lien avec des gestionnaires de stades de football. Elle était aussi dans la course pour travailler à la détection des émotions des passagers du tramway de Nice. Aujourd’hui, elle propose gratuitement des licences aux forces de l’ordre. Leur solution est basée sur des techniques d’intelligence artificielle qui permettent de scanner en temps réel l’ensemble des flux de vidéosurveillance à l’échelle de plusieurs villes. Cette plateforme analyse ainsi les attroupements, les gens trop près les uns des autres qui ne respectent pas les mesures de distanciation sociale.
Nous sommes vraiment dans cette logique panoptique numérisée très inquiétante. Avant, ces entreprises vivaient de la peur liée à l’insécurité, à la délinquance et au terrorisme. Beaucoup des acteurs que nous dénonçons et dont nous essayons de documenter les programmes et les visées se sentent légitimés par la crise du coronavirus. Ils ont l’impression que leurs technologies policières servent enfin à quelque chose, qu’elles pourraient permettre de relancer la machine économique au plus vite.
Que dénoncez-vous exactement par solutionnisme technologique ?
Le terme est notamment utilisé par Evgeny Morozov, qui propose cette notion dans son livre Pour tout résoudre cliquez ici – L’aberration du solutionnisme technologique [4]. Il entend par là l’idée que la technologie résoudrait des problèmes politiques, sans avoir à les travailler, à y réfléchir autrement. On se tourne vers la technologie, et ce faisant, nous écartons nombre d’autres manières d’aborder les problèmes. Pour moi, le terme renvoie aussi à la tendance de la civilisation à penser que la technologie est vectrice de progrès social et politique.
Le big data en est l’un des aspects. Par exemple, une professeure en sciences de la santé canadienne, qui se trouvait en Sierra Leone au moment de l’épidémie d’Ebola de 2014, raconte comment des chercheurs de Harvard sont arrivés dans le pays avec une idée basée sur le big data. Ils voulaient appliquer à cette épidémie un modèle qu’ils avaient conçu sur la base d’une épidémie de paludisme au Kenya quelques années plus tôt. Ils ont donc voulu avoir accès à toutes les données télécom de la population de Sierra Leone pour modéliser leurs déplacements et donc tenter de modéliser la propagation de l’épidémie, pour concentrer au mieux les ressources en personnel médical et équipements sur les zones qui seraient les plus à risque.
De fait, ils n’ont pas réussi à avoir accès aux données des opérateurs de télécom, pour des raisons de vie privée. De toute façon, leur modèle épidémiologique était faux, le virus ne se transmettait pas par les voyageurs et les migrations internes, mais avant tout autour des rites funéraires. Ça, les soignants de terrain et les anthropologues le savaient, mais pendant plusieurs mois, on s’est concentré sur des approches technologiques. Il y a une fétichisation de la technologie [5]. Le risque est grand qu’on reproduise le même type d’erreur dans cette pandémie.
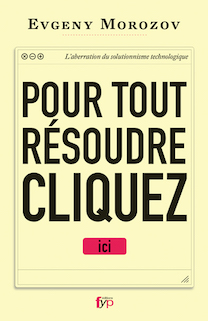
Dans ces épidémies, il y a d’un côté des envies de solutions technologiques complexes, de l’autre des mesures très archaïques, la quarantaine, l’interdiction stricte de sortir…
Michel Foucault décrit les sociétés de souveraineté, avec des punitions et des châtiments, les sociétés disciplinaires où on enferme les corps, où on quadrille l’espace, puis les sociétés sécuritaires, à l’ère des flux, où il faut gérer ces flux grâce à la machine informatique. Souvent, on retient cette typologie comme une succession de régimes, alors qu’en fait, ils se recombinent, avec des focales différentes. Aujourd’hui, nous sommes clairement dans un régime sécuritaire avec la gestion des flux comme source de pouvoir, combinée à une approche plus individualisante que permet la technologie. Mais cela se fait toujours en combinaison avec des formes de contrôle social beaucoup plus archaïques et coercitives.
Typiquement, concernant l’application de tracking, pour que cela soit efficace, ceux qui deviendront les suspects contagieux risquent de faire face à un appareil coercitif en partie informatisé, mais beaucoup plus autoritaire que ce qui est annoncé, avec des quarantaine imposées. C’est déjà le cas quand on voit comment les obligations de confinement et leur imposition mobilisent l’appareil policier, comment toute la communication du confinement pointe du doigt les récalcitrants, les brebis galeuses qui ne respectent pas ces obligations, les passagers clandestins de la lutte contre l’épidémie. C’est aussi une manière de cultiver une forme de tempérament autoritaire, où les gens doivent se surveiller les uns les autres. Apparemment, la plateforme d’appels de la police française déborde de dénonciations de personnes qui ne respecteraient pas les mesures de confinement. En Nouvelle Zélande, les autorités ont mis en place une plateforme numérique de délation. Les serveurs ont crashé tellement il y avait de signalements.
Nous sommes au cœur d’un événement fracassant, c’est dur de savoir de quel côté on va retomber, peut-être que ce sera du côté d’une critique du néolibéralisme, peut-être que le débat sur le tracking des contacts fera que la protection de la vie privée reprendra le dessus et qu’on rejettera les appareils de surveillance. En attendant, des aspects inquiétants augurent une accélération d’un contrôle autoritaire, équipé de technologies présentées comme les seules solutions possibles pour sortir de cette crise.
Il n’est pas aisé de continuer à porter publiquement des positions libertaires, de défense radicale des libertés, dans ce moment d’épidémie ?
Ce n’est pas confortable d’être confiné, et nous sommes sûrement privilégiés par rapport à nombre de nos concitoyens confinés dans des logements insalubres ou minuscules, dans des situations très difficiles. Malgré tout, à la Quadrature, nous voulons tenir ces positions, porter ce discours critique. On voit beaucoup de gens plutôt proches de nos préoccupations qui, parce que c’est la crise, disent qu’il faut accepter temporairement des mesures d’exception. Nous sommes convaincus que ce n’est pas de ce côté qu’il faut chercher, qu’en mettant l’accent sur la surveillance par la technologie, on s’empêche d’engager des formes de transformation sociale plus profondes. Celles-ci semblent pourtant à portée de main puisqu’une série de dogmes et de modes de pensée viennent se fracasser contre la vague pandémique. Mais cette transformation sociale ne sera possible que si nous ne contribuons pas à consolider l’appareil sécuritaire.
Recueilli par Rachel Knaebel
Le site de Technolopolice, la campagne de la Quadrature du net sur les outils de surveillance des technologies de « smart city » ou « safe city ».
| Nos entretiens sur la crise du Covid-19 : |