AVANT-PROPOS : les articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » ne représentent pas les positions de notre tendance, mais sont publiés à titre d’information ou pour nourrir les débats d’actualités.
SOURCE : Contretemps
Extrait de : Alain Bihr et Michel Husson, Thomas Piketty : une critique illusoire du capitalisme, Paris/Lausanne, Syllepse/Page-2, 2020.
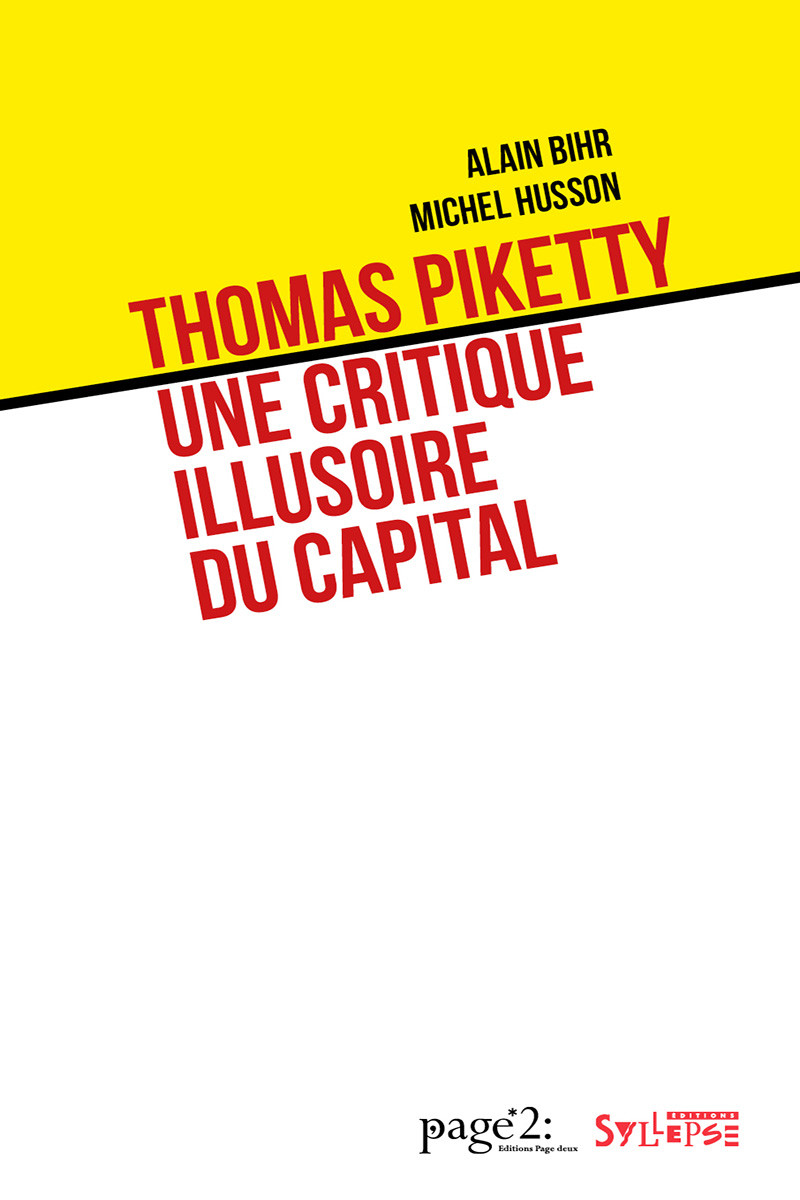
Le moment social-démocrate ou l’histoire réduite à un théâtre d’ombres
Les propositions politiques que formule Thomas Piketty, sur lesquels nous nous arrêterons en fin d’ouvrage, se situent explicitement dans la lignée de la social-démocratie européenne, dont elles entendent en un sens poursuivre et parachever l’œuvre. Il est donc intéressant d’examiner au préalable la manière dont il explique et comprend l’émergence des forces social-démocrates dans leur diversité, leur montée en puissance dans le cours de la première moitié du 20esiècle, qui va les amener jusqu’à exercer des responsabilités gouvernementales aux États-Unis comme en Europe, de manière continue ou non, enfin leur déclin à la fin de ce même siècle.
La nébuleuse genèse de « l’État fiscal et social »
Pour Piketty, l’ascension des forces social-démocrates procède, à titre d’effet et de cause, d’un mouvement plus général caractérisé par « l’effondrement du poids de la propriété privée qui se déroule dans ces pays entre 1914 et 1945 ». Cet effondrement s’explique lui-même pour partie par les destructions occasionnées par les deux guerres mondiales mais surtout par « une multitude de décisions politiques » dont le commun dénominateur aura été de
« (…) réduire l’emprise de la propriété privée : expropriations d’actifs étrangers ; nationalisations ; contrôle des loyers et des prix immobiliers ; réduction du poids de la dette publique par l’inflation, par l’imposition exceptionnelle des patrimoines privés, ou son annulation pure et simple (…) l’invention de progressivité fiscale de grande ampleur au cours de la première moitié du XXe siècle, avec des taux supérieurs à 70 %-80 % sur les plus hauts revenus et patrimoines, qui se sont maintenus jusqu’aux années 1980-1990 » (page 490-491)[1].
Mais par quels miracles (ou par quels malheurs, c’est selon !) un tel revirement a-t-il eu lieu ? Et quel rôle y ont joué les forces social-démocrates ? Pour Piketty, des facteurs politico-idéologiques ont été décisifs en l’occurrence :
« Les différentes décisions financières, légales, sociales et fiscales prises entre 1914 et 1950 furent certes le produit de logiques événementielles spécifiques. Elles portent la marque des évolutions politiques passablement chaotiques propres à cette période, et elles témoignent de la façon dont les groupes qui se retrouvèrent alors au pouvoir tentèrent de faire face à des circonstances inédites, et auxquelles ils étaient souvent peu préparés. Mais ces décisions renvoient également et surtout à des transformations profondes et durables des perceptions sociales du système de propriété privée, de sa légitimité et de sa capacité à apporter la prospérité et à protéger des crises et des guerres. Cette remise en cause du capitalisme privé était en gestation depuis le milieu du XIXe siècle, avant de se cristalliser en opinion majoritaire à la suite des conflits mondiaux, de la révolution bolchevique et de la dépression des années 1930. Après de tels chocs, il n’était plus possible de continuer de s’en remettre à l’idéologie qui avait été dominante jusqu’en 1914, à base de quasi-sacralisation de la propriété privée et d’une croyance absolue dans les bienfaits de la concurrence généralisée, que ce soit entre les individus ou entre les États. » (Page 491)
C’est donc bien une véritable « révolution idéologique », procédant à la désacralisation de la propriété privée (essentiellement celle des patrimoines plutôt que celle du capital), qui, selon Piketty, est à l’origine de la dynamique qui a permis à la social-démocratie de triompher : « C’est ainsi que les forces politiques en présence se retrouvèrent à proposer de nouvelles voies, en particulier diverses formes de social-démocratie et de socialisme en Europe ou de New Deal aux États- Unis » (page 492). Mais il note aussi en passant que cette révolution idéologique a été conditionnée par la pression exercée sur les élites politiques des États concernés par ces « circonstances inédites » qu’ont été les deux guerres mondiales, la formation de l’URSS et la « grande dépression » des années 1930. Si ces « circonstances » ne figurent ici qu’en toile de fond de la « révolution idéologique » qui accapare toute l’attention de Piketty, elles passent au contraire au premier plan dès lors qu’on entreprend d’expliquer l’avènement de cette dernière (pourquoi s’est-elle produite et pourquoi à ce moment-là ?) et plus encore son contenu (de quelles transformations socioéconomiques et institutionnelles s’est-elle accompagnée ?).
En effet, cette « révolution » aura notamment conduit à « la montée en puissance de l’État fiscal et social » (page 534), c’est-à-dire à une augmentation de la part des recettes, composées d’impôts et de cotisations sociales, de l’ensemble des administrations publiques (État central, collectivités locales, administrations de sécurité sociale, etc.) dans le revenu national : en gros, elle sera passée de moins de 10 % à la veille de la Première Guerre mondiale à quelque 30 % au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour atteindre entre 40 et 50 % dans les années 1970-1980 (page 535). Une hausse qui s’explique presque entièrement par celle « des dépenses sociales liées à l’éducation, à la santé, aux retraites et aux autres transferts et revenus de remplacement » (page 536) : la croissance de « l’État fiscal » aura surtout été celle de « l’État social », les recettes affectées aux missions régaliennes de l’État (armée, police, justice, administration, infrastructure de base) n’ayant pour leur part progressé sur la même période que de 8 % à 12 %[2].
« Cette évolution spectaculaire n’a été possible qu’à l’issue d’une transformation radicale des rapports de force politico-idéologiques au cours de la période 1910-1950, tout cela dans un contexte où les guerres, les crises et les révolutions démontraient au grand jour les limites du marché autorégulé et le besoin d’un encastrement social de l’économie » (page 537).
Il est donc temps de considérer les différents éléments de ce « contexte », leur spécificité et leur importance relative dans cette « évolution spectaculaire » et, au passage, d’évaluer la manière dont en traite Piketty. Le moins qu’on puisse en dire est qu’elle laisse beaucoup à désirer. Qu’on en juge !
On peut considérer que les deux guerres mondiales constituent une même séquence historique, une sorte de seconde guerre de Trente Ans (1914-1945)[3], dont l’épicentre aura été européen (puisque l’Europe constitue alors encore le centre du monde) mais dont la dimension aura été mondiale, à l’échelle de la domination européenne et des enjeux du conflit entre puissances européennes. Tournant le dos à cette perspective, Piketty se penche pour sa part surtout sur la Première Guerre mondiale dont date, selon lui, la montée en puissance de « l’État fiscal et social » ; et sa principale préoccupation à son sujet est de savoir si, comment et dans quelle mesure ce conflit aura contribué à cette montée, notamment à l’instauration d’un impôt progressif sur le revenu et sur les successions patrimoniales (pages 541-544). Ce qui revient aussi à souligner inversement que ce même conflit n’a en rien contribué à l’institution de « l’État social » stricto sensu.
Chemin faisant, c’est à peine s’il évoque en quelques lignes les processus qui ont conduit à ces déflagrations planétaires, en se contentant de vagues remarques à leur sujet :
« En l’occurrence, la Première Guerre mondiale n’est pas un événement exogène que la planète Mars aurait catapulté sur Terre. Il n’est pas interdit de penser qu’elle a été causée, au moins en partie, par les très fortes inégalités et tensions sociales qui minaient les sociétés européennes d’avant 1914. Les enjeux économiques étaient également très forts. Nous avons vu par exemple que les placements étrangers rapportaient à la France et au Royaume-Uni entre 5 % et 10 % de revenu national supplémentaire à la veille de la guerre, apport considérable et en progression accélérée au cours de la période 1880-1914, et qui ne pouvait qu’aiguiser les convoitises. De façon générale, les placements financiers franco-britanniques s’accroissaient de façon tellement rapide entre 1880 et 1914 qu’il est difficile d’imaginer comment cette trajectoire aurait pu se poursuivre à ce rythme sans susciter d’énormes tensions politiques, aussi bien au sein des pays possédés que des rivaux européens. De tels montants avaient en outre des conséquences non seulement pour les propriétaires français et britanniques, mais également pour la capacité des différents pays à mener des politiques fiscales et financières permettant de garantir la paix sociale. « page 543)
Faisant allusion à ce propos à L’impérialisme, stade suprême du capitalisme, Piketty ne s’arrête pas à discuter la pertinence de l’analyse léniniste, encore moins celle du concept d’impérialisme plus généralement. Comme il n’ignore pas l’ouvrage de Lénine, il faut en conclure que son contenu lui paraît soit sans importance soit sans pertinence pour son sujet, tout comme plus généralement le concept d’impérialisme tel qu’il a pu être élaboré et discuté à l’époque[4]. Du coup, restent totalement dans l’ombre et hors du propos de Piketty des processus aussi importants pour la compréhension de la phase du devenir-monde du capitalisme qui a précédé et préparé la conflagration de la première moitié du 20e siècle que la centralisation monopoliste des capitaux dans lequel le capitalisme européen est engagé depuis le dernier tiers du 19e siècle ; la fusion dans ce cadre du capital industriel et du capital bancaire en un capital financier d’un type nouveau ; le développement supérieur de l’exportation de capitaux sur l’exportation des marchandises dans le contexte d’une nouvelle étape du devenir-monde du capitalisme ; la compétition entre grandes concentrations monopolistes pour le partage du marché mondial des marchandises et des capitaux ; la concurrence pouvant aller jusqu’au conflit et à l’affrontement entre les États (les grandes puissances européennes, auxquelles vont rapidement se mêler les États-Unis et le Japon) pour le partage et repartage du monde en zones d’influence (au profit des capitaux monopolistes dont ils sont les représentants), allant des colonies aux États alliés subordonnés en passant par les protectorats (semi-colonies) et le contrôle indirect des États faibles (périphériques ou semi-périphériques).
Piketty n’est guère plus disert sur l’autre source du déchaînement de violence qui aura caractérisé cette période, à savoir l’exacerbation des conflits de classe, qui va conduire notamment à une série de révolutions et de contre-révolutions, conduisant souvent à des guerres civiles, au cœur ou en marge des deux conflits mondiaux. Sur le continent européen, l’épicentre en aura été la poussée révolutionnaire qui aura accompagné la fin de la Première Guerre mondiale, en Russie, en Hongrie, en Allemagne, en Italie, conduisant à l’instauration du régime soviétique dans le premier cas, à différentes formes de réaction autoritaire dans les autres ; une séquence qui se répètera, à moindre échelle cependant, à la faveur de la Seconde Guerre mondiale, la résistance armée au fascisme (en France, en Italie, en Tchécoslovaquie, en Yougoslavie, en Grèce) venant considérablement renforcé la capacité conflictuelle des forces populaires tout en l’enfermant dans un cadre stato-national. Toute la phase historique ici envisagée (1914-1945) est d’ailleurs marqué par une intense mobilisation de ces forces et des luttes qu’elles mènent, même lorsqu’elles ne prennent pas une allure révolutionnaire et que, sous la conduite des formations social-démocrates, elles conduisent, au contraire, à la conclusion de compromis avec la classe dominante, ainsi qu’on le verra encore.
Dans le développement qu’il consacre à cette phase aiguë de la lutte des classes (pages 545-548), Piketty est certes contraint de concéder que cette dernière a joué son rôle dans l’avènement de cet « État fiscal et social » qui lui est cher, tout en cherchant malgré tout à la subordonner à des évolutions politico-idéologiques de plus grande ampleur dont elle aurait simplement précipiter la conclusion en somme :
« Les réflexions et les débats autour de la justice sociale, de l’impôt progressif et de la redistribution des revenus et de la propriété, déjà très présents au XVIIIe siècle et pendant la Révolution française, prirent une ampleur nouvelle dans la plupart des pays à partir de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, compte tenu notamment de la très forte concentration des richesses générée par le capitalisme industriel et des progrès de l’éducation et de la diffusion des idées et de l’information. C’est la rencontre entre cette évolution intellectuelle et un ensemble de crises militaires, financières et politiques, en partie causées par les tensions inégalitaires, qui conduisit à la transformation du régime inégalitaire. Les mobilisations et les luttes sociales jouèrent un rôle central, de même que les évolutions politico-idéologiques, avec des spécificités propres à chaque histoire nationale (…) » (page 548).
Certains exemples qu’ils donnent contredisent pourtant cette minoration de l’importance des luttes sociales dans l’avènement de « l’État fiscal et social » relativement aux « évolutions politico-idéologiques » antérieures. Ainsi en France :
« Dans les débats français de 1920, quand les groupes politiques qui refusaient en 1914 l’impôt sur le revenu avec un taux de 2 % se mirent subitement à voter des taux de 60 % sur les plus hauts revenus, un aspect qui ressort clairement est la peur de la révolution, dans un contexte où des grèves générales menacent d’embraser le pays, et où la majorité des militants socialistes choisit de se rallier à l’Union soviétique et à la nouvelle Internationale communiste dirigée par Moscou. Par comparaison au risque d’une expropriation généralisée, l’impôt progressif paraît soudainement moins effrayant. Il en va de même lors des grèves quasi insurrectionnelles qui ont lieu en France en 1945-1948 (particulièrement au cours de l’année 1947). Le renforcement de la progressivité fiscale et la mise en place de la Sécurité sociale paraissent de moindres maux aux yeux de tous ceux qui craignent une révolution communiste. » (page 546).
Mais aussi en Suède :
« C’est le mouvement ouvrier et social-démocrate suédois, à travers une exceptionnelle mobilisation populaire entre 1890 et 1930, qui a conduit à la transformation d’un régime propriétariste exacerbé (où un seul électeur fortuné avait parfois plus de droits de vote aux élections municipales que l’ensemble des autres habitants d’une commune) en un régime social-démocrate, caractérisé par un ambitieux État social et une forte progressivité fiscale. » (pages 546-547)
Ces exemples auraient dû inciter Piketty à se pencher de plus près sur ces forces social-démocrates qui, partout en Europe, vont jouer un rôle décisif dans l’instauration de « l’État fiscal et social », par conséquent sur le modèle de mouvement ouvrier, né dans le dernier tiers du 19e siècle dont elles sont les représentants politiques : sur sa composition sociale (mêlant base ouvrière et paysanne et fraction publique de la classe de l’encadrement[5]), sur ses formes d’organisation (associations, syndicats et parti, avec prévalence de ce dernier) et de lutte (combinant grèves et élections), sur sa stratégie (centrée sur l’exercice du pouvoir d’État), sur son idéologie (où la prédominance du marxisme d’inspiration allemande se décline selon les différentes traditions nationales). Cela lui aurait permis de comprendre que l’État social et fiscal qui l’intéresse tant était, de la sorte, déjà inclus dans les objectifs de lutte de ce mouvement, tant à court terme (les hausses de salaires, la réduction du temps de travail, la réglementation du travail, surtout l’instauration d’une protection sociale contre les accidents du travail, la maladie, le chômage, la vieillesse, etc.), qu’à plus long terme (le socialisme).
Plus fondamentalement encore, cela l’aurait amené à s’interroger sur les rapports existant entre l’émergence de ce type de mouvement ouvrier et les transformations des formes d’exploitation et de domination que connaît le capital entre les années 1880 et les années 1920 : le passage d’un régime d’accumulation à dominante extensive (impliquant l’augmentation de la durée et de l’intensité du travail) à un régime à dominante intensive (qui repose principalement sur une hausse de productivité du travail, toujours plus ou moins assortie cependant de celle de son intensité), moyennant la parcellisation et la mécanisation des procès de travail, conduisant à la généralisation du taylorisme et du fordisme, dont le travail à la chaîne sera l’archétype ; une concentration et une centralisation accrues du capital, partant aussi du prolétariat, accompagnée de sa « massification » progressive (homogénéisation tendancielle de ses conditions d’emploi, de travail, de rémunération, d’existence en général), deux facteurs propres à favoriser sa mobilisation syndicale et politique sur une vaste échelle spatiale ; une augmentation forte et continue de la demande de forces de travail (en dépit de sa baisse relativement au volume de la production, correspondant à la hausse de la productivité) que risque de ne pas pleinement satisfaire le recours à l’exode des populations rurales, tant celles des métropoles capitalistes que celles de leurs colonies, rendant par conséquent nécessaire la mise en place d’embryons de protection sociale (prestations familiales, construction de maternités, de crèches et de logements salubres, instauration de dispensaires, prise en charge des soins médicaux dans un cadre hospitalier ou non, etc.) ; la nécessité d’une formation générale et professionnelle minimale de la force de travail (celle des ouvriers qualifiés, en plus de celle des techniciens et ingénieurs), pour la rendre employable dans les secteurs les plus divers, ce que ne permet que médiocrement le recours à l’apprentissage ou à la formation sur le tas, conduisant à l’instauration d’une scolarité primaire obligatoire ; etc. Cela permet de comprendre pourquoi et comment des nécessités nées de nouvelles formes d’exploitation et de domination capitaliste ont pu commencer à recouper des revendications issues de la base prolétaire, relayées par les organisations du mouvement ouvrier, en se conjuguant finalement pour donner naissance à « l’État fiscal et social » qui intéresse tant Piketty. En tout cas mieux que l’évocation nébuleuse des « évolutions politico-idéologiques » qui lui tient lieu de schème explicatif majeur.
La même carence d’analyse des transformations des rapports capitalistes de production se manifeste dans la manière dont Piketty appréhende le troisième élément du « contexte » qui a présidé selon lui à l’instauration de « l’État fiscal et social » : « les limites du marché autorégulé et le besoin d’un encastrement social de l’économie ». En fait, il se contente ici de reprendre terme à terme l’analyse développée par Karl Polanyi dans La grande transformation (pages 548-559)[6]. Non sans lui faire subir une inflexion caractéristique :
« Dans La Grande Transformation, Polanyi propose en 1944 une analyse magistrale de la façon dont l’idéologie du marché autorégulé du XIXe siècle a conduit selon lui à la destruction des sociétés européennes depuis 1914, et finalement à la mort du libéralisme économique. » (page 548)
Dans cette formulation se retrouve une nouvelle fois la réduction permanente par Piketty des rapports sociaux à leur seule dimension idéologique. Car ce que Polanyi analyse, ce n’est pas d’abord ni essentiellement la faillite dans les années 1920-1940 de « l’idéologie du marché autorégulé » mais, plus fondamentalement, celle d’un régime de reproduction du capital qui fait reposer la régulation de ce dernier sur les seuls mécanismes de marché. Et ce que Polanyi démontre, et que Piketty rappelle, c’est que la régulation marchande (la loi de l’offre et de la demande) opère médiocrement voire pas du tout sur le marché du travail, le marché des terres et des ressources naturelles, le marché de l’argent (marché monétaire et marché financier) ainsi qu’au sein des rapports entre les principales puissances étatiques européennes (pages 549-550). Mais si cette peut en partie se reprendre, elle échoue à expliquer pourquoi cette régulation purement marchande a malgré tout été opérante en gros depuis la fin du 18e siècle (la révolution industrielle) jusqu’à l’entre-deux-guerres pour faire finalement faillite lors de la « grande dépression » des années 1930. Tout simplement parce que, tout comme Piketty, Polanyi n’est pas en mesure d’appréhender les transformations survenues au sein des rapports capitalistes de production qui ont fini par rendre cette régulation inopérante, en ne lui permettant plus de corriger (ne serait-ce que temporairement) les effets des contradictions internes à ces rapports.
Dès lors, en effet, que le capital adopte un régime d’accumulation intensive, fondée sur des gains constants de productivité, il devient nécessaire que s’établisse des mécanismes de partage de ces gains de productivité entre augmentation des salaires (réels, directs et indirects) et augmentation des profits, de sorte que soient assurés les équilibres intersectionnels qui conditionne la reproduction du capital social dans son ensemble[7]. Peuvent évidemment y contribuer les règles contractuelles régissant la formation et la progression des salaires directs dans les grands groupes industriels et commerciaux, concrétisation du capital concentré et centralisé, et dans les principales branches industrielles où ils opèrent, règles résultant de négociations entre les organisations professionnelles des salariés (syndicats) et celles des capitalistes, règles assorties (ou non) du maintien de rapports de force entre elles, règles qui joueront d’ailleurs aussi un rôle régulateur de la concurrence entre ces groupes capitalistes. A défaut de l’établissement de pareilles règles par voie contractuelle entre « partenaires sociaux », c’est à l’État qu’il reviendra de s’en charger. Et, dans la mesure où le partage des gains de productivité met également en jeu la formation et la progression des différentes prestations (en nature ou en espèces) constituant le salaire indirect, l’intervention de l’État est de toute manière requise pour fixer des procédures et des règles concernant chacune de ces prestations (leur montant, les conditions de leur perception, etc.) mais aussi les prélèvements obligatoires (sous forme de cotisations sociales ou d’impôts) chargés de les financer (leurs assiettes, leurs taux, etc.) De la sorte, « l’État fiscal et social » devient l’élément clé d’une régulation des marchés, dont l’arsenal pourra le cas échéant se compléter ou se renforcer par le biais de sa politique salariale (par exemple la fixation d’un salaire minimal et le contrôle de son évolution), de l’ensemble de sa politique budgétaire (de ses dépenses tout comme de ses recettes), enfin de sa politique monétaire (le contrôle du crédit via la Banque centrale et le contrôle du taux de change).
Récapitulons. Qui ne se contente pas, comme Piketty, d’appréhender les guerres, les révolutions et contre-révolutions et les crises économiques, qui ont ponctué la scène historique européenne et mondiale entre 1914 et 1945, comme un simple « contexte » propre à favoriser des « évolutions politico-idéologiques » possédant leur autonomie propre, y découvrent au contraire les causes et effets à la fois des transformations opérées dans les rapports capitalistes de production au sein des États centraux (européens et nord-américains) entre 1880 et 1920, qui ont rendu nécessaire le passage d’un État libéral, simple gardien et gendarme des marché, en un État interventionniste chargé 1) de réguler les marchés en assurant un partage de la valeur ajoutée entre salaires et profits ; 2) de prendre en charge les conditions socialisées de la reproduction du travail vivant (la force de travail) et du travail mort (les équipements productifs socialisées : infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, production d’énergie et de matières premières, etc.) que le capital privé ne parvient pas à produire ou seulement insuffisamment et médiocrement ; 3) d’assurer le maintien d’un « équilibre de compromis » (Gramsci) entre bourgeoisie et prolétariat, notamment en intégrant autant que possible les organisations du mouvement ouvrier dans et par des pratiques et structures de négociation, en en faisant payer le prix à la bourgeoisie sous forme de politiques fiscales et sociales redistributives ; 4) de gérer de manière aussi non conflictuelle que possible les rapports entre les principaux États centraux, par l’établissement d’institutions chargées de contrôler et de réguler la circulation internationale du capital (ce sera la fonction du GATT[8], du Fonds monétaire international, de Banque mondiale et de ses déclinaisons « régionales ») et de prévenir et régler les conflits persistants entre États (ce sera la fonction de l’Onu), le tout sous l’égide de l’hégémonie états-unienne et d’un duopole États-Unis/URSS. Ce qu’il appelle « l’État fiscal et social », auquel la social-démocratie va pour partie attacher son nom, n’est finalement que le produit de toute cette dynamique des rapports de production, des rapports de propriété, des rapports de classe et des rapports internationaux, dont Piketty ne souffle mot, tout simplement parce qu’ils les ignorent ou ne les méconnaît pour l’essentiel. Sans quoi on ne comprendrait pas qu’il puisse évoquer l’œuvre de la social-démocratie dans ces termes :
« (…) les pays nominalement capitalistes sont en réalité devenus entre 1950 et 1980 des sociétés sociales-démocrates, avec des mélanges variables de nationalisation, de système public d’éducation, de santé et de retraite, et d’impôt progressif sur les plus hauts revenus et patrimoines. » (page 567)
Bel exemple de cette mise sens dessus-dessous du monde et de cette inversion du sens des mots qui est le propre de l’idéologie[9]. Car, en réalité, tout un chacun l’aura compris : désignées nominalement comme social-démocrates, les sociétés capitalistes occidentales sont bien restées réellement, durant ces quelques décennies, des sociétés intégralement capitalistes, au sein desquelles l’emprise du capital n’aura pas cessé de s’exercer bien que sous des formes nouvelles et quelquefois inattendues.
Heurs et malheurs du réformisme social-démocrate
Nous allons retrouver cette même méconnaissance par Piketty des rapports sociaux qui structurent les sociétés capitalistes dans la manière dont il explique le déclin politique que les forces social-démocrates ont connu au cours de ces dernières décennies. Selon lui, trois facteurs se seraient conjugués pour le précipiter, qui présentent un commun dénominateur : la social-démocratie n’a pas pu, voulu ou su pousser à bout son œuvre réformiste :
« Tout d’abord, les tentatives d’instituer de nouvelles formes de partage du pouvoir et de propriété sociale des entreprises sont longtemps restées cantonnées à un petit nombre de pays (Allemagne et Suède en particulier), et n’ont jamais été véritablement explorées autant qu’elles auraient pu l’être, alors même qu’elles apportent l’une des réponses les plus prometteuses pour un dépassement de la propriété privée et du capitalisme. Ensuite, la social-démocratie n’a pas su répondre efficacement au profond besoin d’accès égalitaire à la formation et aux connaissances, et en particulier lors de la transition de la révolution primaire et secondaire à celle de l’enseignement supérieur. Nous analyserons enfin les limites de la réflexion sociale-démocrate sur l’impôt, et notamment sur l’impôt progressif sur la propriété. En particulier, la social-démocratie n’a pas réussi à bâtir de nouvelles formes fédérales transnationales de souveraineté partagée et de justice sociale et fiscale. De fait, la concurrence exacerbée entre pays, dans le cadre d’une mondialisation où les traités de libre-échange et de libre circulation des capitaux tiennent lieu de toute régulation (et auxquels les sociaux-démocrates n’ont pas su proposer d’alternative, quand ils ne les ont pas eux-mêmes inspirés), met gravement en péril en ce début de XXIe siècle le consentement fiscal et le contrat social sur lequel s’est bâti l’État social-démocrate au cours du XXesiècle. » (pages 567-568).
Or, en chacun de ces facteurs, nous allons retrouver à l’œuvre les rapports capitalistes de production et leur dynamique propre que la social-démocratie était censée avoir réduit à l’état de réalités « nominales » et qui vont finir par se jouer de ses projets, réalisations ou velléités réformistes.
Premier terrain sur lequel s’est déroulé ce « drame » : les avancées de la social-démocratie en matière de « propriété sociale » du capital. Entendons par là que « les salariés participent à la direction des entreprises et partagent le pouvoir avec les actionnaires privés (et le cas échéant publics), éventuellement en les en évinçant complètement » (page 576), instituant donc des formes de cogestion des entreprises associant représentant des salariés et représentation des actionnaires. Piketty en détaille les deux exemples phares : celui de l’Allemagne et celui de la Suède (imités par l’Autriche, le Danemark et la Norvège). En Allemagne, sous la pression syndicale et dans le contexte des exigences de la reconstruction, une loi institue en 1951 l’obligation pour toutes les grandes entreprises produisant du charbon et de l’acier de réserver la moitié des sièges de leur conseil d’administration et des droits de vote à des représentants des salariés ; l’année suivante, cette obligation est étendue à l’ensemble des grandes entreprises, tous secteurs confondus, la part des salariés dans les conseils d’administration et les droits de vote étant cependant réduite au tiers ; enfin, en 1976, le gouvernement social-démocrate de Helmut Schmidt généralise cette dernière obligation à toutes les entreprises de plus de cinq cents salariés, celle de plus de deux mille étant contraintes pour leur part de réserver la moitié des sièges et des droits de vote aux représentants des salariés. En Suède, où la concentration du capital est moindre, la loi de cogestion (datant de 1974, étendue en 1980 et 1987), toujours à l’initiative de gouvernements social-démocrates opérant sous pression syndicale, prévoit en gros un tiers des sièges et des droits de vote dans toutes les entreprises de plus de vingt-cinq salariés.
Que l’institution de ces régimes de cogestion n’ait en rien modifié la nature capitaliste de ces entreprises, c’est ce que nous verrons encore dans le dernier chapitre de cet ouvrage, quand nous examinerons les propositions politiques de Piketty, qui accorde une place de choix à la « propriété sociale » tout comme à la « propriété temporaire »[10]. Piketty est d’ailleurs implicitement et subrepticement contraint de le reconnaître lorsqu’il évoque les limites auxquels ces régimes de cogestion et leur extension se sont heurtés.
« (…) l’une des principales limitations de la cogestion à l’allemande est que la parité, en l’absence d’un actionnariat salarié ou public supplémentaire, est en partie un leurre. En cas d’égalité des voix, ce sont en effet les administrateurs choisis par les actionnaires qui disposent de la voix décisive, par exemple pour nommer la direction de l’entreprise ou pour choisir sa stratégie d’investissement ou de recrutement. Cette voix décisive est exercée par le président du conseil, qui est toujours un représentant des actionnaires. Un autre point essentiel à prendre en compte est que la plupart des entreprises allemandes sont gouvernées non pas par un conseil d’administration unique (comme cela est le cas dans la plupart des pays), mais par une structure bicéphale composée d’un conseil de surveillance et d’un directoire. Les représentants des salariés disposent alors de la moitié des sièges au conseil de surveillance, mais compte tenu de la voix prépondérante des actionnaires ces derniers peuvent nommer tous les membres qu’ils souhaitent au directoire, qui est la structure de direction opérationnelle de la société. » (pages 581-582)
En somme, dans ces instances de cogestion, les représentants des salariés sont finalement cantonnés à la figuration tandis que les rênes du pouvoir restent bien entre les mains des représentants du capital (par actions), comme il se doit dans une entreprise capitaliste, ne fût-elle que « nominalement » telle… Dès lors, on peut aussi légitimement supposer que ce sont ces mêmes représentants du capital (et leurs valets politiques) qui ont fait obstacle à la diffusion des projets et expériences de cogestion au-delà de l’aire germanique et scandinave, par exemple en France et en Grande-Bretagne. Mais, plutôt que d’accuser ces derniers, ce qui reviendrait à reconnaître leur persistance et leur puissance, rien moins que « nominales », Piketty préfère pour sa part s’en prendre au fétichisme de la « propriété publique » (la propriété d’État), qui aurait conduit les socialistes et communistes français et les travaillistes britanniques à préférer les nationalisations à la cogestion ; ce qui le conduit même à se féliciter de l’abandon par les uns et les autres, au cours des années 1980 et 1990, de ce dogme d’un autre âge, qui ouvrirait ainsi la voie à leur ralliement à la sage vision cogestionnaire (pages 586-590). Quitte à se contredire en déplorant par ailleurs que cet abandon ait fait partie du ralliement de la majeure partie d’entre eux au néolibéralisme qu’il honnit[11].
Deuxième terrain sur lequel la social-démocratie a été tenue, au moins partiellement, en échec selon Piketty : celui de justice scolaire. Alors qu’elle aurait fait merveille au cours du 20e siècle en soutenant et parachevant l’universelle accession à l’enseignement primaire et secondaire, elle aurait été prise en défaut lorsqu’il s’est agi, en gros à partir des années 1980-1981, de « démocratiser » l’accès à l’enseignement supérieur.
« À l’âge de l’enseignement primaire et secondaire, il existait une plate-forme égalitaire assez évidente en matière d’éducation : il fallait conduire la totalité d’une classe d’âge à la fin de l’école primaire, puis à la fin du secondaire, avec pour objectif que chaque enfant accède approximativement aux mêmes savoirs fondamentaux. Avec l’enseignement tertiaire [l’enseignement supérieur], les choses sont devenues beaucoup plus compliquées. Outre qu’il paraît peu réaliste de conduire la totalité d’une classe d’âge au niveau du doctorat, tout du moins dans un avenir proche, le fait est qu’il existe naturellement une diversité considérable de filières et de voies au niveau de l’enseignement supérieur. Cette diversité reflète pour partie la légitime multiplicité des savoirs et des aspirations individuelles, mais elle tend également à s’ordonner de façon hiérarchique, et à conditionner fortement les hiérarchies sociales et professionnelles futures. Autrement dit, l’entrée dans l’âge de la tertiarisation de masse pose un défi politique et idéologique d’une nature nouvelle. Il devient inévitable d’accepter une forme durable d’inégalité éducative, en particulier entre des personnes poursuivant des études supérieures plus ou moins longues. Cela n’empêche évidemment pas de concevoir de nouvelles formes de justice dans la répartition des ressources et dans les règles d’accès aux différentes filières. Mais cela devient une tâche plus complexe que l’affirmation d’un principe d’égalité absolue face au primaire et au secondaire. » (page 630)
En fait, cette présentation relève davantage de l’image d’Épinal que de l’histoire effective de l’enseignement. En nous en tenant provisoirement au seul cas français, on peut clairement affirmer que l’égalité effective d’accès d’une classe d’âge à l’enseignement primaire et plus encore secondaire n’y a jamais été assurée. Si la scolarité obligatoire a amené presque tous[12] les enfants de classes populaires à fréquenter l’école primaire jusqu’à douze ans puis jusqu’à quatorze ans (on en a vu plus haut les raisons), pour y préparer un certificat d’études primaires que seule une partie d’entre eux passait et réussissait, ce n’est pas pour y recevoir le même enseignement que les enfants de la bourgeoisie ou même de la petite-bourgeoisie qui, parallèlement, fréquentaient le « petit lycée » (les sections primaires des lycées publics, préparant à intégrer les cycles de l’enseignement secondaire au sein de ces derniers), les établissements privés (généralement catholiques) ou qui recevaient un enseignement privé à domicile[13]. Même par la suite, l’enseignement primaire s’est trouvé partagé entre une filière « primaire professionnelle » et un autre « secondaire supérieure »[14]. C’est cette même logique de filières et de séries, officielles et officieuses, qui aura prolongé et perpétué les inégalités scolaires au sein de l’enseignement secondaire, y compris après que celui-ci se sera largement « démocratisé » : si plus de 80 % d’une classe d’âge atteint aujourd’hui le niveau du baccalauréat, qui osera prétendre que le diplôme décroché dans une série professionnelle au sein d’un obscur lycée de province est équivalent à celui obtenu dans une série générale au sein d’un lycée d’élite parisien ? Et les inégalités qui se manifestent au sein de l’enseignement supérieur, dominé par la filière passant par les classes préparatoires pour déboucher sur les grandes écoles d’ingénieur ou les écoles supérieures de commerce, ou encore par celle conduisant des Institut d’études politiques à l’École nationale d’administration (ENA), n’en sont que la conséquence et le prolongement, ainsi que doit finir par le reconnaître Piketty lui-même : « Les étudiants issus des milieux favorisés sont souvent en meilleure situation pour accéder aux filières les plus prometteuses, à la fois du fait des transmissions familiales et d’un accès préalable à de meilleurs lycées et écoles » (page 632). C’est donc à tous les niveaux de l’appareil scolaire que l’on aura rencontré cette « diversité considérable de filières et de voies » que Piketty croit aujourd’hui découvrir au sein du seul enseignement supérieur.
En fait, il ne saurait en aller autrement dans des sociétés qui ne sont pas seulement nominalement mais bien réellement capitalistes, c’est-à-dire placées sous l’emprise des rapports capitalistes de production et de classe et des inégalités structurelles qu’ils font naître et reproduisent sans cesse dans l’ordre de la répartition des revenus, dans celui de la division sociale du travail et dans celui enfin de l’accès à la culture (entendons : la seule culture réputée légitime, celle que viennent sanctionner succès et diplômes scolaires et universitaires). Car c’est cette même réalité persistante des rapports capitalistes de production, que Piketty ignore ou dont il dénie l’importance, qui est venue infliger un cruel démenti aux rêves de « justice scolaire » de la social-démocratie de même qu’elle a réduit ses réalisations en matière « propriété sociale » à la portion congrue que l’on sait. Et Piketty est bien obligé d’en convenir, en reconnaissant finalement les effets propres à ces rapports sur les conditions d’accès à l’enseignement, en contradiction avec ses affirmations antérieures sur leur caractère purement « nominal ». Tant il est vrai qu’à forcer de « tricher » avec la réalité, on finit par se piéger soi-même !
On sait que, des différents facteurs précédents qui génèrent des inégalités en matière de scolarité, il tend à privilégier les inégalités de revenu, en négligeant celles dérivant de la division capitaliste du travail[15]. Mais, en l’occurrence, ce n’est pas gênant, au contraire. Car, dans un contexte d’austérité budgétaire généralisée (commandée par la concurrence fiscale introduite par la libéralisation du mouvement des capitaux et par un endettement public croissant auquel les résorptions des suites de la crise financière de 2007-2009 ne sont pas étrangères), les dépenses consacrées à l’enseignement supérieur n’ont pas augmenté à la mesure de la demande de formations universitaires et assimilées. C’est d’ailleurs ce que note Piketty : « Au moment même où les pays développés sont entrés dans l’âge de la tertiarisation de masse, et où la proportion d’une classe d’âge accédant à l’enseignement supérieur est passée d’à peine 10 %-20 % à plus de 50 %, l’investissement éducatif public (exprimé en pourcentage du revenu national) a stagné » (page 632). Et, du coup, la part du coût de ces formations qui restent à la charge des étudiants et de leurs familles s’est accrue, creusant du même coup les inégalités entre eux dans la poursuite d’études supérieures. Le phénomène est particulièrement accentué aux États-Unis :
« (…) des travaux récents ont montré que l’accès à l’enseignement supérieur était aux États-Unis surdéterminé par le revenu parental. Concrètement, la probabilité d’accès à l’université était au milieu des années 2010 comprise entre 20 % et 30 % pour les enfants les plus pauvres, et montait quasi linéairement jusqu’à plus de 90 % pour les enfants les plus riches. Les données similaires disponibles pour les autres pays, bien que très incomplètes, ce qui est en soi problématique, suggèrent que la courbe est moins pentue. » (page 624).
C’est que la capacité des parents à assumer le coût des études supérieures de leurs enfants (frais de scolarité, loyers et charges locatives, cotisations sociales, entretien ordinaire, etc.) augmente évidemment en fonction du niveau de leurs propres revenus. Tout comme, plus généralement, les parents riches ou aisés peuvent davantage aider leurs enfants, sans d’ailleurs que cela pèse proportionnellement plus sur leur budget. S’agissant de la France, par exemple :
« les parents de jeunes adultes appartenant au dernier décile (niveau de vie supérieur à D9) dépensent en moyenne 7 053 euros en aides et achats pour leur jeune adulte, pour un taux d’effort global de 8 %, tandis que les plus modestes (niveau de vie inférieur D1) dépensent cinq fois moins (1 308 euros) pour un taux d’effort presque 1,6 fois plus important (13 %) »[16].
La troisième et dernière pierre d’achoppement sur laquelle a trébuché la social-démocratie selon Piketty est la fiscalité : elle n’aurait pas su préserver et défendre son idéal de justice fiscale, pas plus que celui de justice scolaire ou de justice en matière de « propriété sociale ». Deux facteurs idéologiques y auraient contribué selon lui. D’une part :
« la foi dans la centralisation étatique comme solution unique au dépassement du capitalisme a parfois conduit à ne pas prendre suffisamment au sérieux la question de l’impôt, de ses taux et des assiettes, tout comme la question du partage du pouvoir et de la répartition des droits de vote au sein des entreprises » (page 638). D’autre part : « les mouvements sociaux-démocrates, socialistes et travaillistes n’ont pas su développer les coopérations internationales nécessaires pour préserver et approfondir l’impôt progressif, quand ils n’ont pas eux-mêmes organisé les conditions d’une concurrence fiscale dévastatrice pour l’idée même de justice fiscale » (ibidem).
A son habitude, Piketty est ici essentiellement préoccupé de scruter les représentations (idéologiques) et les représentants (politiques), en laissant du coup dans l’ombre les rapports sociaux (de production et de classe) dont ils sont précisément les représentations et les représentants. Du coup, cela le rend incapable d’expliquer l’inertie ou au contraire les changements survenus au sein des premiers. Ainsi doit-il se contenter de constater sans plus que :
« Les mouvements sociaux-démocrates ont poursuivi depuis 1950 la construction de l’État fiscal et social dans le cadre étroit de l’État-nation, avec des succès incontestables, mais sans véritablement chercher à développer des formes politiques fédérales ou transnationales nouvelles (…). Faute d’avoir su ancrer la solidarité et la fiscalité à l’échelon postnational, comme l’illustre l’absence emblématique de tout impôt commun et de politique sociale commune en Europe, la social-démocratie a contribué à fragiliser les constructions développées au niveau national et à mettre en péril sa base sociale et politique. » (page 639)
Cette apparente inconséquence social-démocrate s’explique pourtant aisément. Comme nous l’avons vu plus haut, « l’État fiscal et social », que la social-démocratie contribue a édifié, est partie intégrante du régime de reproduction du capital mis en place dans l’entre-deux-guerre, ordinairement dénommé fordiste ou keynésiano-fordiste, dont la régulation suppose la maîtrise par chaque État-nation de sa politique budgétaire (dont la fiscalité est une composante essentielle), tout comme de sa politique monétaire et de sa politique salariale. Dans ces conditions, une coopération fiscale transnationale, par exemple dans le cadre de la Communauté économique européenne (CEE) constituée en 1957, aurait été au mieux inutile, au pire contre-productive.
Quant à « la concurrence fiscale dévastatrice pour l’idée même de justice fiscale », elle n’a pas attendu la social-démocratie pour devenir aujourd’hui la règle. Certes, Piketty a raison de rappeler « le rôle central joué par les sociaux-démocrates européens, et singulièrement par les socialistes français, dans le mouvement de libéralisation des flux de capitaux qui se met en place en Europe puis dans le monde à partir de la fin des années 1980 » (page 643). Mais il doit, là encore, se contenter de ce constat amer faute de comprendre ou, du moins, de prendre en compte que ce « mouvement de libération des flux de capitaux » n’a pas d’abord été l’effet de la (bonne ou mauvaise) volonté de la social-démocratie européenne, œuvrant en partenariat avec la démocrates-chrétiens et les libéraux, mais le résultat d’une la crise du précédent régime fordiste de reproduction du capital, dont les modalités du procès de production étaient parvenues à épuisement tandis que dont le mode de régulation, à base stato-national, éclatait sous l’effet de l’internationalisation croissante de la circulation des marchandises et des capitaux. S’amorce alors un nouveau régime de reproduction du capital, dont les politiques néolibérales vont constituer le fer de lance, auxquelles vont se rallier dans le cours des années 1980, de gré ou de force, la quasi-totalité des gouvernements de la planète, au Sud comme au Nord et à l’Est comme à l’Ouest, quelle qu’ait été leur couleur politique. Politiques de libéralisation du mouvement des capitaux sous toutes leurs formes et de déréglementation de l’ensemble des marchés, qui conduiront à instaurer en effet une concurrence méthodique entre régimes fiscaux, conduisant au dumping fiscal (en matière de fiscalité du capital et des revenus du capital – ce qui chagrine Piketty), dumping dont l’enjeu est la localisation ou délocalisation des capitaux au sein des États, mais aussi une concurrence plus féroce encore entre les travailleurs logés au sein de ces États (ce que Piketty ne mentionne pas), opposés entre eux et mis tous ensemble sous la pression d’une « armée industrielle de réserve » de dimension planétaire[17].
Remarquons au passage que, en chacune des deux phases ici rapidement évoquées, les forces social-démocrates se sont toujours comportées, en dernière instance, en représentantes et défenseuses des intérêts du capital. Quitte à devoir brûler aujourd’hui les idoles idéologiques qu’elles adoraient hier (par exemple les nationalisations, l’État-providence, etc.) et, inversement, à porter aux nues ce que précédemment elles vouaient aux gémonies (par exemple l’initiative privée, le marché, la finance, etc.) Derrière l’inconséquence dont s’étonne et que leur reproche Piketty, il y a la continuité d’une posture politique dont seule la prise en compte des changements survenus dans les conditions de reproduction du capital peut expliquer la sinuosité apparente[18].
*
Résumons notre propos. Telle que comprise et présentée par Piketty, l’évolution politique et idéologique des sociétés ouest-européennes et nord-américaines du XXe siècle se présente comme un théâtre d’ombres, sur l’écran duquel se succèdent et se bousculent des silhouettes énigmatiques, sans qu’on sache ni pourquoi et comment elles prennent forme ni ce qui préside à leur apparition ou disparition. Faute que soient pris en compte à chaque fois les rapports sociaux, notamment de production et de classe, qui se trouvent représentés politiquement et idéologiquement dans et par ces figures. Ce qui permet de rappeler que, quand on entreprend une étude historique :
« (…) on ne part pas de ce que les hommes disent, s’imaginent, se représentent, ni non plus de ce qu’ils sont dans les paroles, la pensée, l’imagination et la représentation d’autrui, pour aboutir ensuite aux hommes en chair et en os; non, on part des hommes dans leur activité réelle, c’est à partir de leur processus de vie réel que l’on représente aussi le développement des reflets et des échos idéologiques de ce processus vital. Et même les fantasmagories dans le cerveau humain sont des sublimations résultant nécessairement du processus de leur vie matérielle que l’on peut constater empiriquement et qui repose sur des bases matérielles. De ce fait, la morale, lareligion, la métaphysique et tout le reste de l’idéologie, ainsi que les formes de conscience qui leur correspondent, perdent aussitôt toute apparence d’autonomie. Elles n’ont pas d’histoire, elles n’ont pas de développement ; ce sont au contraire les hommes qui, en développant leur production matérielle et leurs rapports matériels, transforment, avec cette réalité qui leur est propre, et leur pensée et les produits de leur pensée. »[19]
Notes
[1] Emporté par l’enthousiasme que lui inspirent ces mesures « attentatoires » à la propriété privée, Piketty confond ici manifestement le taux marginal d’imposition avec son taux moyen. Une confusion qu’il réédite page 540.
[2] Le graphique 10.15, qui représente ces données page 537, ne fait cependant nullement apparaître le bond spectaculaire des dépenses liées aux deux guerres mondiales, financées essentiellement par recours au crédit (national ou international), ni par conséquent le poids du service de la dette ainsi engendrée dans l’affectation des recettes publiques.
[3] Souvent mêlée à celle de « guerre civile européenne », cette notion se trouve chez des auteurs aussi divers que Ernst Nolte, La guerre civile européenne. National-socialisme et bolchévisme, Paris, Éditions des Syrtes, 2000 [1987] ; Eric J. Hobsbawm, L’âge des Extrêmes. L’histoire du court XXe siècle, Bruxelles, Ed. Complexe, 1999 ; Mark Mazower, Le continent de ténèbres. Une histoire du XXe siècle, Bruxelles, Complexe, 2005 ; Enzo Traverso, À sang et à feu. De la guerre civile européenne 1914-1945, Paris, Stock, 2007. Merci à Yannis Thanassekos pour ces références bibliographiques.
[4] Les principales contributions à ce débat ont été celles de John Hobson, L’impérialisme (1902), de Rudolf Hilferding, Le capital financier, (1910), de Rosa Luxemburg, L’accumulation du capital (1913), de Nicolas Boukharine, L’économie mondiale et l’impérialisme (1917), avant L’impérialisme stade suprême du capitalisme de Lénine (1917) qui s’est fortement inspirée de la précédente.
[5] Cf. Alain Bihr, Entre bourgeoisie et prolétariat : l’encadrement capitaliste, Chapitre VII, Paris, L’Harmattan, 1989.
[6] Karl Polanyi, La grande transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps, Gallimard, 1983. L’ouvrage est originellement paru en 1944.
[7] La nécessité d’équilibres entre volume et rythme de l’accumulation du capital au sein des deux sections productives fondamentales, celle productrice des moyens de production et celle productrice des moyens (biens) de consommation, a été établie par Marx dans la Section III du Livre II du Capital. Tout comme la difficulté d’y parvenir qui fait que ces équilibres ne peuvent en définitive résulter que des déséquilibres sans cesse corrigés, tant du moins que des politiques économiques et sociales ad hoc ne sont pas déployées.
[8] Le General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) ou Accord général sur les droits de douane et le commerce, institué en 1947 à l’initiative des États-Unis, était un organisme visant à libéraliser les échanges internationaux par la conclusion de traités de commerce entre États. A la suite d’un dernier round (cycle) de négociation entre 1986 et 1994, il a cédé la place à l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
[9] Karl Marx et Friedrich Engels, « (…) dans toute l’idéologie, les hommes et leurs conditions apparaissent sens dessus dessous comme dans unecamera obscura », L’idéologie allemande, page 17.
[10] Cf. infra.
[11] De même faut-il mentionner sa méconnaissance complète de l’autogestion, une alternative radicale à la cogestion, qui le conduit à écrire : « Les débats sur l’autogestion ont souvent suscité de grands espoirs, par exemple en France, dans les années 1970. Mais ils sont restés généralement à l’état de slogan et n’ont guère débouché, faute de s’être matérialisés dans des propositions précises. » (page 598).Visiblement Piketty n’a pas entendu parler de Lip et des quelque deux cents autres entreprises fonctionnant en autogestion après occupation et reprise de la production par leurs salariés autour de 1975 ; pas plus que de l’élaboration, à la même époque, de contre-plans définissant les modalités d’une généralisation de l’autogestion à des aires urbaines ou même des régions entières. Il faut dire qu’il se réfère en l’occurrence à un ouvrage de Pierre Rosanvallon, un des maîtres d’œuvre du ralliement de la gauche française, syndicale, politique et intellectuelle, au néolibéralisme.
[12] Mais pas tous ! Ainsi, mon grand-père maternel, né en 1894, alors que la scolarité primaire était obligatoire depuis 1882, n’a jamais fréquenté l’école. Aîné d’une famille qui allait compter quinze enfants, il a été placé par ses parents comme valet de ferme à l’âge de six ans (une bouche de moins à nourrir !), avant de devenir ouvrier d’usine à douze ans. Et il n’a pas été le seul enfant de sa génération dans ce cas.
[13] Cf. Antoine Prost, L’enseignement en France 1800-1967, Paris, Armand Colin, 1968, pages 412-423.
[14] Cf. Christian Baudelot et Roger Establet, L’école primaire divise, Paris, Maspero, 1975.
[15] Cf. supra, page ????. J’y reviendrai encore quant j’examinerai les propositions politiques de Piketty, pages ????.
[16] Sébastien Grobon, « Combien coûte un jeune adulte à ses parents ? », Les revenus et les patrimoines des ménages, édition 2018, Insee, Paris, 2018, page 75. Il s’agit du montant des dépenses annuelles.
[17] Sur tous ces points, cf. les articles « Crise » et « Libéralisation » dans Alain Bihr, La novlangue néolibérale. La rhétorique du fétichisme capitaliste, 2e édition, Page 2/Syllepse, Lausanne/Paris, 2017.
[18] Piketty poursuit son analyse des évolutions récentes des formations social-démocrates dans les chapitres 14 à 16 de son ouvrage. Il y met l’accent sur l’éclatement de leur base sociale sous l’effet de l’aggravation des inégalités scolaires, qui les a conduites à représenter de plus en plus la classe de l’encadrement, et plus particulièrement ses couches supérieures, les plus diplômées, et de moins en moins le prolétariat, en se transformant de la sorte en une « gauche brahmane ». La place me manque ici pour discuter cette analyse, qui supposerait de revenir sur les transformations en cours des rapports de classe dans les formations centrales. Pour ce qui est de la France, à ce sujet, je renvoie à Alain Bihr, La farce tranquille. Normalisation à la française, Paris, Spartacus, 1986 ; « Mai-juin 1968 en France : l’épicentre d’une crise d’hégémonie », A l’encontre, avril ; « Mai-juin 1968 en France. Offensive prolétarienne et contre-offensive capitaliste », A l’encontre, mai ; et « France, le moment Macron », A l’encontre, 4 juillet 2017.
[19] Karl Marx et Friedrich Engels, L’idéologie allemande, op.cit., page 17.
