AVANT-PROPOS : les articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » ne représentent pas les positions de notre tendance, mais sont publiés à titre d’information ou pour nourrir les débats d’actualités.
SOURCE : Le vent se lève

Publié en août 2020, aux éditions Syllepse par Thomas Posado et Jean Baptiste Thomas, Révolutions à Cuba de 1868 à nos jours, retrace 150 ans de luttes et de soulèvements à Cuba. En traitant de la guerre d’indépendance débutée en 1868, de la Révolution de 1933 ou de la chute de Baptista en 1959, ce livre raconte par le bas la continuité historique d’un combat des subalternes cubains pour l’émancipation. Si l’arrivée au pouvoir de Fidel Castro marque un grand bond en avant pour ces velléités d’émancipation, elle témoigne aussi de ce que les auteurs analysent comme la naissance d’un « État ouvrier déformé », qui empêche la constitution d’une véritable démocratie par le bas. Ces contradictions initiales sont de fait primordiales pour comprendre les ambiguïtés actuelles de l’État cubain qui oscille entre attachement aux principes socialistes et réformes libérales. Entretien réalisé par Xavier Vest.
Le Vent Se Lève – Dans les années 1810, sur le continent sud-américain, la bourgeoisie créole à l’image de Bolivar débute un processus d’indépendance victorieux vis-à-vis de la Couronne espagnole. Pourtant Cuba ne sera indépendant qu’en 1898 après la guerre d’indépendance avec l’arrivée des États-Unis dans le conflit. Comment expliquer que l’île soit restée si longtemps dans le giron espagnol contrairement à ses voisins?
Jean Baptiste Thomas – Il y a une sorte de paradoxe un peu idéologique dans la question cubaine car dans le discours véhiculé par les institutions scolaires en France, on a l’impression que Cuba devient une question géopolitique centrale à partir de la crise des missiles. Cela occulte le fait que sans l’argent de la Nouvelle Espagne et du Nouveau Pérou et sans le sucre de la Caraïbe, l’Europe et le Système monde actuel n’auraient jamais existé tel quel. De ce point de vue, la Caraïbe est un enjeu stratégique pour les puissances européennes bien avant l’entrée des américains dans cette zone pour en faire leur arrière-cour. Pour la Couronne d’Espagne, Cuba est une base très importante pour son appui dans la tentative de décolonisation de l’Amérique du Sud dans les années 1810 ce qui explique que l’île devient une place forte royaliste et jusqu’au-boutiste. Le deuxième élément est le fait qu’avec le boom sucrier cubain lié à la révolte des esclaves à Saint-Domingue (Haïti) qui rompt avec la France, Cuba devient une île sucrière et un joyau de la Couronne pour des questions géostratégiques et économiques. À partir de ce moment, la bourgeoisie blanche de Cuba devient polarisée autour de la question noire. Elle défend alors deux options pour préserver sa rente sucrière : soit la position jusqu’au-boutiste en restant dans le giron espagnol ou la position annexionniste en rejoignant les États-Unis d’Amérique. Il y a donc une double tension anti-bolivarienne qui structure les axes idéologiques sur lesquels se construit cette bourgeoisie sucrière liée au marché international ce qui aura des conséquences importantes jusqu’en 1959.
LVSL – A partir de 1868 a lieu sur l’île un long processus de remise en question de l’autorité espagnole qui va mener à l’indépendance en deux parties avec tout d’abord la Guerre de dix ans de 1868 à 1878 puis la guerre d’indépendance de 1895 à 1898. Ce processus d’indépendance résulte-t-il d’une opposition spontanée venant d’une base populaire de travailleurs ruraux et d’esclaves ou à l’inverse d’une petite bourgeoisie intellectuelle organisée?
JB .T. – Le processus de rupture est préalable à 1868. Il est lié à l’influence qu’ont les processus d’émancipation et de rupture des colonies face aux métropoles européennes – dans le cas des 13 colonies nord-américaines, de la Révolution à Haiti ou encore des révolutions latino-américaines – sur les secteurs d’une petite bourgeoisie ou de la bourgeoisie créole avancée qui est très influencée par les idées des Lumières et d’émancipation. Mais ces courants restent très minoritaires et surtout leur influence est bridée par une répression féroce qui est vraiment un axe structurant de la politique espagnole sur l’île mais aussi à Puerto Rico ou aux Philippines.
Ainsi, à partir de 1868, l’étincelle et ensuite la nouvelle explosion de 1895 est avant tout le fait de l’est de l’île. Plus qu’une vision d’une alliance entre subalternes et bourgeoisie intellectuelle, c’est l’est de l’île, marginalisé par le centre qui devient le fer de lance de la protestation coloniale. On retrouvera par ailleurs cette configuration géographique en 1933 et dans les années 50 avec la guérilla castriste dans la Sierra Maestra. Cette opposition à l’est de l’île regroupe alors une alliance particulière de petits ou moyens planteurs comme Carlos Manuel de Céspedes, leurs esclaves libérés, des fermiers, des métayers avant d’irriguer tout l’est de l’île. Face à cela, les espagnols vont mettre en œuvre une vraie politique de terre brûlée. Ces expérimentations affreuses de guerre coloniale serviront ensuite pour les puissances européennes en Afrique et en Asie.
LVSL – Dans ce long processus d’indépendance se révèle la figure de José Martí aujourd’hui considéré comme un véritable héros de la nation cubaine. Quelle vision politique désire-t-il imposer à Cuba dans son combat pour l’indépendance ? Est-ce une vision simplement emblématique du libéralisme politique du XIXème siècle ou alors y a-t-il déjà un discours socialiste qui inspirera la Révolution de 1959?
JB.T. – Martí est un intellectuel comme on en fait au XIXème siècle. Il est à la fois journaliste, homme de lettres, poète, chef militaire et politique. Néanmoins, je crois que ce qui le caractérise est une extrême conscience latino-américaine. Le nationalisme cubain, en tout cas celui des secteurs radicaux des indépendantistes, est un nationalisme très inclusif. Est cubain toutes celles et ceux qui luttent pour la liberté. C’est la raison pour laquelle un des chefs principaux de l’insurrection en 1895, Maximo Gomez est dominicain. C’est la raison pour laquelle des petits colons et producteurs espagnols vont rejoindre les rangs de l’insurrection. Cela Martí l’exacerbe et de plus, il est un des premiers à alerter sur le risque pour Cuba à passer sous le giron états-unien car en tant qu’intellectuel havanais, il a à l’esprit les débats qui circulent sur la fausse alternative annexionniste de passer sous protectorat américain pour résoudre le problème colonial. Enfin, il n’y a pas de vision socialiste chez Martí mais en revanche il y a une vision national-populaire. Il comprend que l’échec de 1868-1878 est lié à son impréparation et que l’insurrection est restée trop située à l’est. Ainsi, en 1895, il fait en sorte que l’insurrection soit nationale et mobilise l’ensemble des forces vives de la nation dont les subalternes du centre et de l’ouest de l’île mais également les subalternes qui ont dû s’exiler et travailler aux USA comme les travailleurs du tabac cubains en Floride qui vont financer son parti. Il y a par exemple dans ces travailleurs, Carlos Baliño qui sera ensuite un membre fondateur du Parti Communiste Cubain dans les années 20, qui aura un rôle dans l’insurrection en 1933. Il est donc un passeur entre la génération martíenne du Parti Révolutionnaire Cubain (PRC) et la nouvelle génération qui participe à la Révolution de 1933. Ainsi chez Martí il y a une vision anti-impérialiste américaine et une vision populaire de l’insurrection.
Thomas Posado – C’est vrai que chez Martí, il y a cette conscience anti-américaine que n’ont pas avec cette intensité les autres leaders du processus d’indépendance de l’Amérique du Sud comme Bolivar. Cela est aussi lié au fait que l’impérialisme américain s’est grandement renforcé au cours du 19ème siècle et particulièrement à Cuba.
LVSL – Malgré l’indépendance de 1898, Cuba devient un protectorat soumis à l’impérialisme et au capital américain, dirigé de façon violente par des hommes de paille qui n’hésitent pas à faire exécuter les leaders de l’opposition politique et syndicale. De plus, l’île va devenir au fil du temps un paradis pour les gangsters et le tourisme américain. Pourtant dans un contexte de crise économique, éclate en 1933 une révolution contre le Président dictateur Gerardo Machado. Les forces qui structurent cette Révolution sont-elles issues de la continuité de celles qui ont milité pour l’indépendance et quel rôle y joue le mouvement ouvrier qui a émergé après l’indépendance?
JB.T. – Aujourd’hui tous les historiens, même les plus conservateurs, s’accordent pour dire que les États-Unis en 1898 prennent en otage le processus d’indépendance à Cuba tout comme à Puerto Rico et aux Philippines. Dès le dernier tiers du XIXème siècle, l’île est en fait déjà soumise au capital américain qui a un rôle prépondérant dans l’économie cubaine mais les américains vont mettre en adéquation cette emprise économique avec un régime de domination politique. Ce protectorat permet ainsi de gouverner par l’entremise d’hommes de paille, le plus paradigmatique étant Gerardo Machado. Concernant 1933, c’est une sorte d’anti-modèle par rapport au processus révolutionnaire de 1895-1898. Il est l’œuvre d’une nouvelle génération qui a relu les mises en garde de Martí sur les États-Unis et voit comment les patriotes ont fini par se faire seconder par les États-Unis après l’indépendance. Par conséquent, 1933 est une révolution directement anti-impérialiste dans son contenu avec un rôle cette fois central du mouvement ouvrier qui s’est consolidé dans les secteurs classiques de l’économie cubaine comme la canne à sucre et les transports (docks, ferroviaires). Mais il y a aussi un prolétariat manufacturier qui a émergé pendant le premier tiers du XXème siècle qui va être à l’origine de la grève générale en 1933 qui renverse Machado. Le mouvement révolutionnaire va alors coupler à ses revendications anti-dictatoriales des revendications sociales et économiques. Mais ce processus révolutionnaire ne sera pas conduit par le Parti communiste cubain qui devient rapidement après sa création, dans les années 20, une officine du Parti communiste mexicain qui est lui-même une expression diplomatique de l’URSS. Cette absence du PCC laisse donc un espace à des forces nationalistes de gauche et on retrouvera ce scénario plus tard en 1959 avec une hostilité du PCC face aux organisations qui voudront rejouer le scénario de 1933 et la geste martíenne.
T.P. – L’élément le plus hallucinant du vol de l’indépendance cubaine par les États-Unis c’est l’amendement Platt. C’est un cas unique dans une constitution où une puissance a un droit d’intervention dans les affaires d’un autre pays, droit d’intervention que les États-Unis ne manqueront pas d’utiliser. Pour revenir sur le Parti communiste cubain, les virages que vont faire le Kremlin et le Komintern dans les années 1930 ont des conséquences désastreuses pour la possibilité que le Parti communiste cubain soit vu comme une alternative crédible pour les cubains. Il va démobiliser en 1933 puis au nom d’un front anti-Hitler, il va appeler à soutenir Batista alors que les cubains sont à des milliers de kilomètres de l’Europe.
LVSL – En 1959, le nouvel homme de paille des américains, Fulgencio Batista qui avait réussi à limiter les effets de la Révolution de 1933 est renversé par la lutte armée de Fidel Castro, Guevara, Cienfuegos et les autres guérilleros qui ont la sympathie du prolétariat rural, de l’opposition étudiante et des mouvements ouvriers. Au départ, Castro présente un programme qui peut être qualifié d’anti-dictatorial, démocrate et qui a vocation à opérer des réformes modérées tandis qu’il est accueilli positivement par les États-Unis. Pourtant, dans les mois qui suivent, la Révolution prend une tournure radicale avec une nationalisation des terres, une expropriation du capital privé et national sans indemnisation et une défection des partis libéraux. Comment expliquer cette « Révolution par contrecoup » (Guevara)? Faut-il y voir la leçon du président guatémaltèque Jacobo Arbenz qui se fait renverser par la CIA en 1954 suite à ses réformes agraires après avoir refusé d’armer le peuple?
T.P. – Le renversement d’Arbenz en 1954 a un effet traumatique pour les gauches américaines y compris pour un jeune photographe argentin, Ernesto Guevara qui est présent à ce moment-là. Ce traumatisme du renversement d’Arbenz joue dans la radicalisation certes. Néanmoins, il y a d’autres mécanismes qui sont propres à Cuba avec des mobilisations extrêmement importantes des paysans et des ouvriers pour renverser Batista. Oui il y a une guérilla mais c’est par une grève générale que le gouvernement révolutionnaire advient. En 1959 et en 1960, il s’établit une dynamique liée d’un côté, à une pression des masses et de l’autre côté, à l’entêtement des États-Unis, ce qui va mener le nouveau gouvernement révolutionnaire vers une dynamique de révolution sociale, seule révolution sociale américaine où il y a une expropriation de la bourgeoisie sans indemnisations et un renversement de l’économie de marché. Tous les renversements qui ont eu lieu ensuite en Amérique ne sont jamais arrivés à ce résultat aussi radical. C’est l’entêtement des États-Unis durant le printemps-été 1960 qui emmène Fidel Castro à nationaliser massivement sans indemnités les secteurs de l’économie cubaine. Ce n’était pas le choix initial de Castro quand il commença sa guérilla. Mais c’est quelque chose qui se fait sous la pression des mobilisations mais pas par les mobilisations. Cela aboutit à un « État ouvrier deformé » car ça ne se fait pas par la participation des cubains dès le départ. Cette expression vient de Trotsky qui parle aussi pour la Russie d’un « État ouvrier dégénéré » pour évoquer le passage d’un pouvoir par le bas via les soviets en 1917 à la période stalinienne. Or Cuba n’a jamais connu ce degré de participation. Il y a d’emblée une prise de décisions verticale. Tous les embryons de démocratie de participation ensuite sont étouffés par le gouvernement castriste ou pas considérés par la base. À titre d’exemple, en 1959, le but du gouvernement est de faire des tribunaux d’arbitrage qui donnent souvent raison aux travailleurs mais ça ne se fait pas par les travailleurs. On a une direction qui donne aussi du pouvoir d’achat, des réformes sociales mais qui conserve ce pouvoir décisionnel.
JB.T. – Dans la Révolution cubaine, il faut faire attention à ne pas mettre trop l’accent sur le militaire qui provient souvent de la geste castriste. Certes, Batista est renversé par une insurrection militaire mais cette victoire résulte en dernier recours des masses cubaines et de la grève générale insurrectionnelle de 1958-1959. C’est un élément central pour comprendre cette « trans-croissance progressive » qu’il va y avoir entre une révolution démocratique et une révolution sociale puis socialiste qui se fait par la force des choses. La direction du M-26 sera conséquente à la différence d’autres courants latino-américains politiques dans les promesses qu’elle souhaite mettre en application. Il y a au cours de cette période, d’autres expériences de renversement de dictatures type guerre froide dans un contexte de remise en question de l’hégémonie étasunienne comme celle de Marcos Pérez Jiménez au Venezuela en 1958 mais pourtant ça ne donne pas lieu au même développement. La différence fondamentale à Cuba c’est que cette poursuite de l’activité des classes populaires explique le caractère populaire et social de la Révolution qui devient ensuite socialiste. Guevara utilise cette formule « Révolution socialiste ou Caricature de la Révolution ». Il se rend bien compte que si on ne va pas à des mesures d’expropriation et une subversion du pouvoir établi, on ne peut pas arriver à l’indépendance nationale et avoir une révolution authentiquement populaire.

LVSL – Pour nommer l’État cubain qui naît de la Révolution vous utilisez l’expression « Etat ouvrier déformé » qui revient souvent dans votre livre. Pourtant les classes subalternes s’insèrent souvent dans des organisations syndicales ou politiques comme la Centrale des travailleurs Cubains (CTC), les Comités de défense révolutionnaire (CDR) ou encore la Fédération des femmes cubaines (FMC). Ces structures sont-elles des organes officiels du pouvoir ou permettent-elles une véritable démocratie ouvrière par le bas?
JB.T. – Sur ce type de structures, il y a des organisations créées avant la Révolution de 1959 comme la CTC et les autres qui sont créés ensuite comme les CDR ou la FMC. Dans les deux cas, ce qui joue avant tout, c’est qu’il y a une marge d’autonomie, d’indépendance et d’auto-représentation limitée pour les subalternes cubains pour un certain nombre de raisons politiques. Il n’existe pas de façon importante des courants qui défendent ce type de politiques autonomes, ce n’est pas la politique du PCC et les cadres militaires et politiques du M-26 qui bénéficient d’un énorme prestige n’ont pas un bagage politique marxiste révolutionnaire qui insisterait sur l’auto-représentation des subalternes. Pour eux, un processus qui garantit la participation suffit. Tout ça est donc limité d’entrée de jeu et ça va peser plus tard.
Guevara voit déjà ces lacunes et il comprend que la faible participation démocratique va entraver la bonne marche de la Révolution du point de vue de la production. D’un point de vue politique, ça sera catastrophique car une fois que la période de plus forte dynamique politique est passée et que la gauche du Mouvement du 26 juillet va se trouver marginalisée vers 1967 et 1968, cette insuffisance d’auto-représentation va alors se cristalliser. Mais on est loin d’être sur un type de régime de socialisme de caserne pas pour des questions de climat tropical mais car il y a une révolution par le bas en 1958-1959 sans que cela débouche sur un régime émancipateur et démocratique.
T.P. – J’avais fait un travail d’archives sur les organisations syndicales sur les premières années de la Révolution. Il y a un véritable prestige du M-26 qui bénéficie d’une adhésion massive et sincère et gagne les les élections syndicales avec une large majorité. Durant l’année 1959, il y a des débats légitimes dans le mouvement ouvrier comme sur l’organisation de la production mais à partir du Xème Congrès de la CTC, en novembre 1959, il n’y a plus de débats dans le camp révolutionnaire. Il y a toujours de l’expression mais pas la possibilité d’exprimer un projet alternatif. Il y a un glacis qui se fait dans un État qui n’a pas encore socialisé les moyens de production. Il n’y a pas encore de bourgeoisie qui a été expropriée mais on a pas de pouvoir à la base ou une démarche de type démocratie de conseils comme c’était souvent imaginé dans la démarche marxiste.
LVSL – Si les années 60 sont emblématiques d’une atmosphère révolutionnaire et émancipatrice avec un pluralisme partidaire et plusieurs courants, à contrario les années 70 sont souvent vues dans l’imaginaire commun comme un raidissement de la Révolution vers un modèle proche des démocraties populaires de l’est et un « socialisme de caserne ». À quoi cela est dû? Par ailleurs, les abus répressifs qui ont été commis à l’image des Unités militaires d’appui à la production sont-ils similaires au système carcéral et répressif en vigueur dans le bloc soviétique à cette époque?
T.P. – Cuba n’a jamais complètement ressemblé à un pays de l’est. Contrairement à ce qui se passe en Pologne ou en Tchécoslovaquie, ce n’est pas une invasion militaire qui est à l’origine du régime en place avec la Libération de 1945 par les troupes soviétiques. À Cuba, la Révolution gagne grâce à une lutte dans laquelle la population est impliquée. Ensuite bien évidemment, Cuba devient dépendant de l’URSS avec le commerce extérieur, ce qui va faire infléchir l’île vers ce modèle avec le parti unique. Mais la direction cubaine jouit d’une légitimité dont ne bénéficient pas les directions communistes en Hongrie ou en Pologne. Ensuite, il y a effectivement ce qu’on appelle le « quinquennat gris » dans les années 70 où on a des mesures répressives qui sont adoptées, le moment emblématique où Castro soutient l’intervention soviétique à Prague en 1968. Il y a de plus une répression des homosexuels à contre-courant de la libération des mœurs qu’avait représenté la Révolution cubaine en 1959, qui reste aujourd’hui un des rares pays avancés en Amérique latine où il est possible d’avorter depuis 1959. La preuve que c’est un modèle différent c’est que l’effondrement de l’Est se fait de manière immédiate avec le processus de restauration en URSS. À Cuba, le régime se maintient dans des circonstances effroyables et des difficultés immenses pour le peuple cubain. Si il n’y a pas de restauration de l’économie de marché c’est donc avant tout lié aux conditions d’établissement.
JB.T. – Il y a, en effet, eu des instruments répressifs mis en place par le régime cubain non pas pour résister à un danger d’invasion ou de restauration financé par les États-Unis mais pour brider la population dont l’expression la plus brutale sont les UMAP. Si ma comparaison n’a pas pour fonction de relativiser, c’est tout de même intéressant de mettre en miroir la façon dont les régimes concentrationnaires d’Amérique du Sud n’ont pas eu la même attention de la part du Département d’État américain. Si on parle d’un environnement concentrationnaire non pas sur un modèle soviétique mais sur un modèle fascisant, c’est l’Argentine, la Bolivie, le Chili, le Brésil pendant les années 70 qui n’ont pas eu la même attention des administrations américaines et européennes.
LVSL – En avril 1961, il y a une tentative de porter un coup fatal à la Révolution par les réseaux anti-castristes avec le débarquement de la Baie des cochons soutenu par la CIA qui échoue notamment grâce à la résistance populaire. Vous montrez d’ailleurs que les données collectées par les services cubains sur les biens cumulés des prisonniers du débarquement sont faramineuses en termes de possession (375 000 hectares de terres, 10 000 maisons, 70 industries, 10 centrales sucrières, 5 mines, 2 banques). Comment les réseaux anti-castristes ont évolué après l’enracinement du régime révolutionnaire. Y a-t-il eu une forme de résignation ou à l’inverse une volonté jusqu’au-boutiste pour renverser le régime par tous les moyens possibles?
T.P. – Non, les réseaux anti-castristes n’ont jamais abdiqué. Il suffit de voir les données déclassifiées de la CIA qui montrent qu’il y a eu 638 tentatives d’assassinat contre Fidel Castro. Mais il est devenu difficile pour eux après l’échec de la Baie des cochons de poursuivre leur lutte sur le territoire cubain. Cette opposition est aujourd’hui encore extrêmement dépendante des États-Unis qui est sa principale ressource politique malgré le blocus qui coûte des milliards de dollars depuis 60 ans. Mais le lien avec la population cubaine a toujours été faible. À Cuba, l’opposition existe mais elle est d’une ampleur très faible pour menacer le gouvernement cubain, ce qui fait qu’elle peut être tolérée puis emprisonnée et vice versa. Un phénomène nouveau voit le jour, ces dernières semaines, avec le Mouvement San Isidro à partir de la détention du rappeur Denis Solis, demandant davantage de liberté d’expression mais on manque de recul pour savoir jusqu’où ira cette contestation.
LVSL – Outre le soutien aux réseaux anti-castristes, les États-Unis ont mis en place à partir de 1962 un embargo économique qui visait à abattre le régime. Néanmoins, les effets de l’embargo furent contenus par les liens que Cuba entretenait avec le bloc de l’Est et l’URSS. Pourtant le début des années 1990 voit la chute de l’URSS et du bloc de l’Est, ce qui conduit à une crise profonde sur l’île baptisée par le gouvernement cubain une « période spéciale ». Cela a t-il conduit à une nouvelle offensive impérialiste des États-Unis et des réseaux anti-castristes durant les années 1990 pour tenter d’abattre le régime de Fidel Castro face aux carences économiques?
T.P. – Oui, de manière « légale » il y a les lois Torricelli en 1992 et Helms Burton en 1996 qui vont durcir l’embargo économique dans une période déjà compliquée. Or, il est évident que pour des raisons humanitaires, il aurait été nécessaire d’assouplir l’embargo. Ce qui rend Cuba comme un pays assez unique dans le monde, c’est la violence des changements d’équilibres commerciaux à la fois en 1959 puis en 1990 quand l’URSS s’en va aussi rapidement qu’elle est venue dans l’économie cubaine. À titre de comparaison, j’ai travaillé sur le Venezuela chaviste. En 2018, avant que Trump prenne des mesures de type blocus contre le Venezuela, les États-Unis étaient, après 20 ans de chavisme , toujours le premier partenaire commercial en terme d’importation et d’exportation au Venezuela et il y avait eu une dizaine de points de baisse du commerce extérieur ce qui est minime comparé à la brutalité des changements qu’a connu Cuba. Donc quand l’URSS s’en va, Cuba se retrouve sans débouchés commerciaux dans un moment où l’économie est globalisée et où il y a peu de soutiens diplomatiques. On se retrouve avec des conditions dramatiques pour les cubains qui vont connaître des fortes dégradations de leurs conditions de vie pour des raisons qui ne sont pas liées au gouvernement cubain.
JB.T. – L’embargo dans sa visée n’est pas économique. D’un strict point de vue de l’entrepreneuriat états-unien, ça n’a aucun sens. À titre d’exemple, Trump en homme d’affaires aurait adoré tout remettre en cause et intervenir dans le secteur touristique dans les années 90. Mais à son arrivée au pouvoir, il a exacerbé les bonnes vieilles méthodes pour des raisons de politique extérieure et de géopolitique. Il y a donc dans l’embargo, une visée avant tout politique et agressive pour créer des conditions d’asphyxie et favoriser un changement de régime. Face à aux méthodes américaines, il y a chez le peuple cubain un degré de résilience qui ne s’explique que par la conscience de ce qu’il y aurait à perdre si les acquis de la Révolution étaient renversés.
LVSL – Concernant les perspectives d’avenir, bien que gardant un attachement à des idéaux socialistes inscrits dans la Constitution de 2019, la bureaucratie cubaine met de plus en plus en œuvre des réformes visant à favoriser les investissements étrangers et à opérer un rétablissement de l’économie de marché. Cela fait-il courir un risque de fragmentation de la société cubaine entre une minorité de gagnants et un retour des inégalités économiques et raciales qui éloignerait les soutiens traditionnels du régime? De plus, ce processus de conversion à une économie de marché produit-il un risque de restauration capitaliste et un retour des émigrés contre-révolutionnaires qui n’ont jamais accepté la Révolution de 1959?
JB.T. – Le régime cubain a fait le choix contraint de mettre en application des réformes de marché pour favoriser l’investissement étranger, l’investissement local et pour répondre aux déformations du modèle économique et social de l’île devenu passablement insurmontable d’un point de vue d’économie classique. Aujourd’hui, concernant les inégalités, ce n’est pas qu’elles risquent de venir car elles sont déjà présentes à un degré encore plus fort que dans les années 90. Le dilemme cornélien pour le régime cubain, c’est que la minorité qui pourrait être gagnante de ses réformes court le risque d’être mise en minorité à son tour par un retour en force du capital cubano-américain qui emporterait en cas de restauration trop avancée les agents de cette ouverture qui aujourd’hui procèdent à petits pas. Les dirigeants cubains savent en effet que ce qui les attend, ce n’est pas l’avenir que Deng Xiaoping avait promis aux bureaucrates communistes chinois mais plutôt de se faire emporter par la vague de la restauration elle-même. La puissance des États-Unis à 150 kilomètres et la force du capital cubano-américain en Floride est bien différente de ce que représentait Taiwan pour la bureaucratie chinoise quand elle s’est ouverte à l’économie de marché.
T.P. – Ce qui se passe actuellement c’est un processus lent qui essaye de rester sur un équilibre entre attirer des investissements sans arriver à constituer une force sociale susceptible de renverser le régime. La restauration de la bourgeoisie cubano-américaine ne me semble pas à l’ordre du jour car elle reste l’otage des calculs des présidents américains. De plus, aujourd’hui, on a une sociologie différente des émigrés cubains présents en Floride. On est passé de l’exil doré de bourgeoisie aigrie des années 60 qui s’était fait nationalisée ses biens à des émigrés plus pauvres qui désirent la liberté de circulation et la possibilité d’envoyer de l’argent à Cuba. Cette nouvelle frange d’émigrés était logiquement plus sensible à la politique d’ouverture de Barack Obama.
LVSL – Outre les perspectives d’avenir, qu’est-ce qu’a révélé la crise sanitaire du Covid-19 sur Cuba?
JB.T. – À Cuba, sur 11 millions d’habitants, il y a eu seulement 7 000 cas de Covid et une centaine de morts. C’est lié au maillage sanitaire et aux réseaux médico-sociaux très développés qui ont permis de faire face à cette catastrophe. C’est très loin des désastres sanitaires proches d’économies comparables comme la République dominicaine ou également plus loin sur les DOM-TOM comme la Martinique. En revanche, les zones qui ont le plus souffert du Covid à Cuba sont les quartiers les plus pauvres du centre comme à La Havane où se concentrent les populations afro-descendantes, ce qui est lié à des problèmes criants de logement et de surpopulation. C’est paradoxal lorsqu’on sait que les premières mesures du gouvernement révolutionnaire étaient liées à l’expropriation et avaient donné lieu à une vaste réforme urbaine avec la construction de grands programmes de logements sociaux. Ça témoigne du prix de trente années de retour progressif à une économie de marché et un retrait progressif des politiques sociales et ce malgré les acquis du système médical cubain.
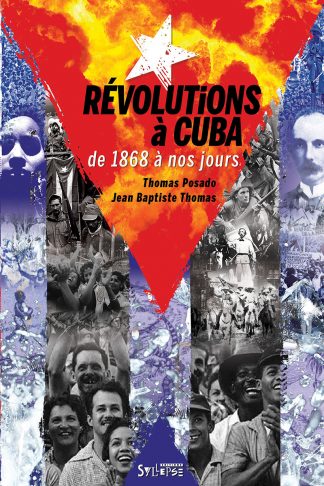
T.P. – On a vu avec le Covid que Cuba a envoyé des médecins en Martinique ou en Italie. C’est paradoxal qu’une île pauvre envoie des médecins chez des grandes puissances. À propos de ces interventions sanitaires, d’un côté Bolsonaro parle d’un « endoctrinement communiste » et du côté de la gauche, certains y voient un élan humaniste. Or c’est un secteur avant tout économique rentable pour l’État cubain qui lui rapporte des milliards de dollars et il faut comprendre que c’est un choix politique du régime d’opérer une spécialisation économique dans ce domaine de la santé. C’est sûr que c’est plus humaniste que produire des armes ou de la haute couture. Il ne faut ni le romantiser ni le diaboliser. C’est une source de revenus qui permet aussi de donner des leçons à des États puissants qui en viennent à avoir besoin de Cuba en cas de crise sanitaire.
