AVANT-PROPOS : les articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » ne représentent pas les positions de notre tendance, mais sont publiés à titre d’information ou pour nourrir les débats d’actualités.
SOURCE : Lundi matin

Alain Bihr a achevé il y a quelques mois la somme de trois mille pages qu’il a consacré au Premier âge du capitalisme. 1415-1763, éditée en trois tomes par Page 2 (Lausanne) et Syllepse (Paris). Le premier tome s’intitule « L’expansion européenne » ; le second, « La marche de l’Europe occidentale vers le capitalisme » ; le troisième « Un premier monde capitaliste » (en deux volumes). Un formidable travail d’analyse historique, sociale et politique sur le devenir-monde du capitalisme, saisi à son commencement. Ivan Segré s’est entretenu, pour lundimatin, avec l’auteur.
- Ivan Segré : Alain Bihr, pouvez-vous nous présenter en quelques mots la somme que vous venez de faire paraître chez Page 2 et Syllepse.
- Alain Bihr : A l’origine de cet ouvrage, Le premier âge du capitalisme, il y a une relecture de la critique marxienne de l’économie politique, centrée sur la question des conditions de reproduction du capital comme rapport social de production, autrement dit la question des conditions de la survie du capitalisme en dépit de ses contradictions internes et des luttes menées contre lui [1]. Cette relecture a conclu, notamment, à la nécessité de revenir sur ce que j’ai appelé le devenir-monde du capital : la manière dont les rapports capitalistes de production ont étendu leur emprise, depuis leur berceau historique, l’Europe occidentale, jusqu’à se subsumer l’ensemble de la planète et l’humanité entière, qui constitue l’une des dimensions fondamentales de la reproduction du capital.J’ai entrepris cette révision sur la base de deux hypothèses principales. Selon la première, que j’ai développée et argumentée dans La préhistoire du capital [2], les rapports capitalistes de production n’ont pu commencer à se former que sur la base, dans le cadre en même temps que contre les rapports féodaux de production ; en somme, paradoxalement, le féodalisme a été la matrice obligée du capitalisme, que celle-ci a dû corrompre et détruire pour en émerger. Ma seconde hypothèse cardinale est que ce qu’on nomme couramment la « mondialisation » n’est pas le point d’arrivée mais le point de départ du capitalisme. Entendons : les rapports capitalistes de production n’ont pu parachever leur formation, entamée dans le cœur du féodalisme européen, qu’à la faveur d’une première mondialisation, celle qui se conduit sous la direction et au bénéfice de l’Europe occidentale sous la forme de son expansion commerciale et coloniale outre-mer (dans les Amériques, sur les côtes africaines, dans la partie maritime de l’Asie), qui débouche sur leur périphérisation inégale, mais aussi sous celle d’une semi-périphérisation du restant du continent européen.
C’est cette seconde hypothèse que développent méthodiquement les trois tomes du Premier âge du capitalisme. Le tome 1 explore les racines, formes, modalités et résultats de l’expansion européenne hors d’Europe, qui constitue le moteur de la dynamique protocapitaliste. Le tome 2 montre précisément comment cette expansion a nourri cette dynamique qui aura permis le parachèvement des rapports capitalistes de production mais qui aura aussi, logiquement, commencé à modeler l’ensemble des pratiques, institutions et représentations sociales pour les conformer aux exigences de déploiement de ces rapports, en faisant ainsi passer les sociétés occidentales d’une structure d’ordres à une structure de classes, en faisant (re)naître l’État sous une forme et une structure toute spécifique, en s’accompagnant d’une série de « révolutions culturelles » (Renaissance, Réforme et Contre-Réforme, Lumières) qui aura donné naissance, entre autres, à une forme originale d’individualité. Le tome 3, enfin, montre comment, sur la base du double mouvement précédent, s’est ainsi formé un premier monde (proto)capitaliste, dont l’Europe occidentale constitue le centre, en proie à une lutte constante pour l’hégémonie ; le restant de l’Europe (nordique, centrale et orientale, méditerranéenne) une semi-périphérie ; les parties sous contrôle européen des Amériques, de l’Afrique et de l’Asie une périphérie ; le tout complété par un chapelet d’empires (ottoman, safavide, moghol, chinois et japonais) constituant les marges de ce monde, plus ou moins capables de résister à la pression européenne tout en y étant exposées.
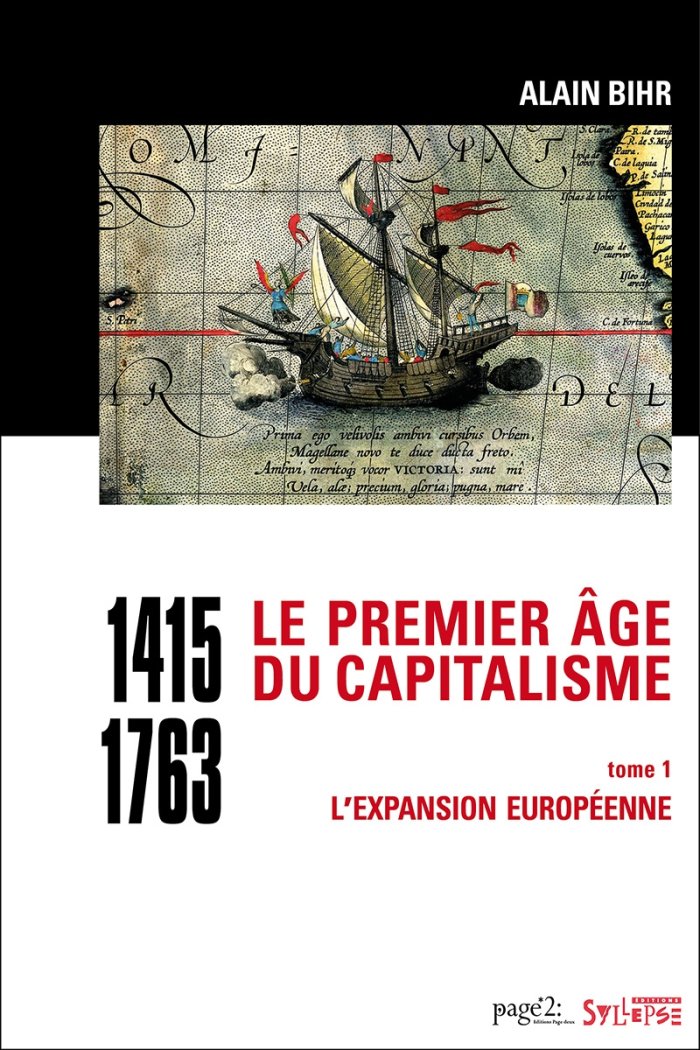
- En quoi votre analyse de la naissance du capitalisme se démarque-t-elle de celles de Fernand Braudel et d’Immanuel Wallerstein ?
- On doit reconnaître à Braudel et à Wallerstein le mérite d’avoir tenté de rendre compte de la naissance du capitalisme comme un tout. Ils ne sont cependant pas les seuls : avant eux, Max Weber et Werner Sombart s’y étaient essayés et, après eux, certaines études inspirés par la global history ou la world history, telle celle d’André Gunder Frank, ont repris le flambeau. Sans oublier de mentionner Samir Amin qui a suivi une voie originale tout au long de son œuvre en la matière.Si je me suis plus particulièrement intéressé à Braudel et à Wallerstein (sans négliger pour autant les autres auteurs précités), c’est pour en montrer les insuffisances, quelquefois graves, alors même qu’ils passent encore couramment pour avoir dit l’essentiel sur la question. Leur commune limite tient au fait qu’ils n’ont pas (c’est le cas de Braudel) ou insuffisamment (c’est le cas de Wallerstein) assimilé la leçon de Marx relative au caractère fondamental des rapports de production, en l’occurrence des rapports capitalistes de production. Le concept est inconnu de Braudel qui ne semble pas avoir lu Marx. On le voit à la manière dont il réduit le capital au capital marchand et dont il assimile le capitalisme à la simple situation de monopole que ce dernier peut acquérir au sein du commerce lointain, souvent avec le soutien d’États (de cités-États ou d’États territoriaux). De ce fait, à partir de sa triade civilisation matérielle – économie – capitalisme, il est incapable de rendre compte de la formation et du développement des rapports capitalistes de production et des parts respectives qu’y prennent, d’une part, la subversion des rapports féodaux sous l’effet du développement de l’économie marchande depuis le cœur du féodalisme européen, d’autre part, l’expansion commerciale et coloniale de l’Europe occidentale en direction des Amériques, des côtes africaines et de l’Asie maritime à partir du XVe siècle.
Quant à Wallerstein, qui semble bien avoir lu Marx, il n’en a néanmoins pas retenu le saut qualitatif que constitue le passage du capital marchand, qui ne se valorise qu’à travers la circulation de marchandises et d’argent, au capital industriel (au sens où l’entend Marx : un capital en fonction simultanément dans le procès de production et le procès de circulation) qui entreprend de se rendre maître des conditions dans lesquelles les marchandises qu’il met en circulation sont produites de manière à se valoriser par l’exploitation de la force de travail qu’il salarie. En conséquence, lui non plus ne fait pas la part entre la dynamique endogène de subversion des rapports féodaux de production en Europe occidentale et celle exogène de l’expansion commerciale et coloniale de cette même partie de l’Europe. Du coup, son analyse de la structure hiérarchique du premier monde capitaliste centré sur l’Europe occidentale demeure trop schématique.
- Vous mettez en lumière le rôle de l’État dans l’émergence du capitalisme. En quoi votre analyse peut-elle éclairer le débat contemporain sur la question de l’État comme pouvoir régulateur ? Autrement dit, l’État est-il voué à servir les desseins du grand capital ou bien peut-il, comme l’ont pensé les révolutionnaires français par exemple, donner forme et force à un intérêt commun ?
- Il est vrai que j’accorde une grande importance à la place et au rôle de l’État dans la dynamique protocapitaliste. Je l’ai fait notamment parce que cette place et ce rôle ont été et restent occultés et niés par la pensée libérale depuis le XVIIIe siècle. Selon cette dernière, le capitalisme se serait formée principalement par l’expansion continue de la sphère des échanges marchands, relativement à laquelle l’État n’aurait été qu’un obstacle à écarter – ce qu’il reste aujourd’hui pour l’essentiel aux yeux de ses défenseurs. Et ce récit statophobe s’est largement diffusé au sein des sciences sociales et notamment de l’histoire, le plus souvent à l’insu de ses protagonistes.Au rebours de ce récit, je montre au contraire que l’État a été au cœur du parachèvement des rapports capitalistes de production. Il est l’acteur central de l’expansion européenne, directement le plus souvent quand celle-ci prend une forme coloniale ; indirectement quand l’État appuie l’expansion commerciale en rendant possible (par les concessions de monopole) la constitution des compagnies commerciales à privilège. Mais on trouve l’État également au cœur de la formation du capital financier (par l’intermédiaire du crédit public), de l’expropriation des producteurs (par l’intermédiaire des enclosures, de l’impôt ou de la guerre), de la « législation sanguinaire » forçant les paysans et artisans expropriés à entrer dans les rets du salariat, de la formation et la consolidation du régime manufacturier, de l’expansion des marchés publics (notamment celui des équipements militaires), de la large gamme des politiques mercantilistes. De même qu’on le trouve au cœur de la constitution de la société civile, qui procède de la contractualisation généralisée des rapports sociaux.
En fait, si l’État est omniprésent dans le parachèvement des rapports capitalistes de production, c’est tout simplement qu’il est un moment (un élément constitutif) nécessaire de ces rapports. Ce que précisément la pensée libérale (et néolibérale) ignore fondamentalement et ce que Marx a au contraire parfaitement compris et mis en évidence : pas de capital sans État. Et c’est bien aussi ce que l’analyse de la formation des rapports capitalistes de production met en évidence. Cette formation marche du même pas que la (re)naissance de l’État sur les ruines de la féodalité, qui était née pour sa part de l’effondrement de l’Empire carolingien et de l’émiettement du pouvoir politique : la formation des rapports capitalistes de production s’accompagne, comme cause et effet à la fois, d’une recentralisation du pouvoir politique sous forme de la reformation d’un appareil d’État. En même temps – et cela redouble encore l’inhérence de l’État aux rapports capitalistes de production – la formation de ces derniers suppose, comme je l’ai montré longuement dans toute une partie du tome 2, une forme particulière d’État (en gros ce qu’on nomme l’État de droit) de même qu’une structure particulière de l’État (composée d’une multiplicité d’États rivaux, en lutte permanente les uns avec les autres, lutte régulée par le triple principe de reconnaissance réciproque de leur souveraineté, d’équilibre des puissances et de domination à caractère hégémonique).
Il faut se pénétrer des principes précédents quand on veut analyser le rapport de l’État aux classes en lutte. Si l’État est fondamentalement au service du capital, ce n’est pas d’abord et essentiellement parce que les gouvernants pratiqueraient systématiquement des politiques favorables à ses intérêts, ceux de la classe capitaliste (qui n’est d’ailleurs pas un bloc homogène et qui est traversée par des conflits d’intérêt) ; ce qui est, cependant, le plus souvent le cas. Plus fondamentalement, l’État est au service de la reproduction du capital précisément en travaillant à l’intérêt général : en assurant la reproduction de la société dans son ensemble, en maintenant son ordre, en la régulant, etc. Car la société dans son ensemble est précisément subordonnée aux exigences de la reproduction du capital : c’est en fonction de ces exigences qu’elle a été façonnée ; le maintien de son ordre est précisément ce que commande la reproduction du capital ; en régulant l’activité sociale, c’est la reproduction du capital qu’il régule.
Cela dit, il faut se rappeler que, précisément parce qu’il est un rapport social d’exploitation et de domination, le capital est aussi en proie à la lutte des exploités et des dominés, qui infléchit constamment le cours de sa reproduction et peut y inscrire, quelquefois, des éléments capables de l’entraver, jusqu’à un certain point. Mais il faut surtout en conclure que, pour s’émanciper de ce rapport de production, il faut affronter l’État et le détruire dans ses formes, structures et fonctions capitalistes.
- Parmi les formations du monde protocapitaliste que vous appelez marginales figure l’Empire chinois, placé d’abord sous la dynastie des Ming, puis sous celle des Qing. Vous lui consacrez un long chapitre à la fin du troisième tome, en revenant notamment sur la question des raisons pour lesquelles le capitalisme ne s’est pas développé en Chine.
- Il conviendrait plutôt de dire : les raisons pour lesquels le développement protocapitaliste n’est pas pu aller à son terme en Chine. Car la Chine impériale, dès la seconde partie de la dynastie Tang (763-907), puis sous les Song (960-1278), plus encore sous les Ming (1368-1640) et les Qing (1640-1911) aura connu l’amorce répétée d’une dynamique protocapitaliste. Notamment à la suite des travaux de Joseph Needham, on a voulu en trouver la raison dans le remarquable essor précoce de toute une série de techniques en Chine, de la métallurgie à la céramique, d’inventions et d’innovations, de la poudre à canon aux caractères d’imprimerie en passant par le bateau de haute mer, qui lui ont conféré une avance de plusieurs siècles voire jusqu’à deux millénaires sur l’Europe. En fait, ces travaux auront surtout montré que le développement protocapitaliste ne trouve pas sa condition suffisante dans l’essor des techniques.Là encore, l’essentiel est à chercher du côté des rapports de production. Notamment dans le régime de la propriété foncière qui lie le paysan chinois à la fois à la terre (dont il est tenancier), à la commune rurale (dont il doit respecter la discipline collective et qui dispose d’une large capacité d’autarcie) et au mandarinat (local et central) dont il est tributaire pour les travaux assurant la régulation des eaux, autant d’éléments qui limite son expropriation potentielle ; dans les entraves apposées au développement du capital marchand, du fait du manque total d’autonomie administrative et plus encore politique des villes chinoises, de l’absence quasi-complète de propriété privée individuelle (la propriété privée reste familiale), du défaut de régulation juridique des échanges (absence de droit civil) ; enfin de l’extrême méfiance du régime impérial à l’égard du commerce extérieur, tout comme plus largement des rapports avec le restant du monde. Cela permet de comprendre comment un développement protocapitaliste est parvenu à s’initier dans la Chine impériale mais a régulièrement tourné court ou végété. Et ce sera le cas jusqu’à ce que la Chine soit contrainte, manu militari, par les puissances européennes de s’ouvrir à leur commerce dans le cours du XIXe siècle, en l’engageant du coup sur la pente de sa périphérisation tendancielle.
J’ajouterai en contrepoint que, soumis à la même contrainte, son voisin japonais a su au contraire relever rapidement le défi occidental. Tout simplement parce que, à l’abri de sa fermeture par les premiers shoguns Tokugawa, dans la première moitié du XVIIesiècle, il avait parachevé son devenir féodal et nourri, de ce fait, les prodromes d’un développement protocapitaliste. Ce qui confirme à mes yeux la fécondité de la matrice féodale dont la Chine n’a précisément pas fait l’expérience.
- Votre travail, par sa rigueur conceptuelle, sa richesse documentaire et sa puissance synthétique, s’adresse à l’honnête homme, quelles que soient ses convictions, mais cela dit, vous êtes également un communiste. Pourriez vous nous dire en quelques mots ce que signifie, pour vous, être communiste aujourd’hui, en termes de convictions intellectuelles, voire anthropologiques ?
- J’ai toujours considéré le communisme comme un humanisme. C’est l’assomption de l’humanité toute entière comme sujet politique : la réalisation des conditions qui permettent aux êtres humains, à tous les êtres humains, de se constituer en communauté(s) politique(s) maîtresse(s) de l’ensemble de leurs conditions matérielles, institutionnelles, imaginaires et symboliques d’existence. Cela suppose évidemment l’abolition de tous les rapports d’exploitation, de domination et d’oppression, qui divisent et hiérarchisent les êtres humains en classes, sexes, ethnies et « races », etc., donc la réconciliation de l’homme (l’être humain) avec l’homme. Mais cela suppose aussi l’instauration d’un autre rapport à la nature, en l’homme (son corps) aussi bien qu’hors de l’homme (le milieu naturel), qui fasse de l’humanité non pas un être démiurgique projetant de se « rendre maître et possesseur de la nature » mais comme l’usufruitier d’un patrimoine, la Terre, dont il a hérité de ses ancêtres et qu’il se doit de transmettre à ses descendants pour leur assurer le meilleur sort qui soit. En quoi je ne fais que paraphraser la définition du communisme esquissé par Marx dans ses Manuscrits de 1844.
[1] Cf. La reproduction du capital, deux tomes, Lausanne, Page 2, 2001. Disponible en ligne : http://classiques.uqac.ca/contemporains/bihr_alain/reproduction_du_capital_t1/reproduction_du_capital_t1.htmlet http://classiques.uqac.ca/contemporains/bihr_alain/reproduction_du_capital_t2/reproduction_du_capital_t2.html
[2] La préhistoire du capital, Lausanne, Page 2, 2006. Disponible en ligne : http://classiques.uqac.ca/contemporains/bihr_alain/prehistoire_du_capital_t1/prehistoire_du_capital_t1.html
