AVANT-PROPOS : les articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » ne représentent pas les positions de notre tendance, mais sont publiés à titre d’information ou pour nourrir les débats d’actualités.
SOURCE : Lundi matin
Nos amis d’Antiopées nous ont transmis une nouvelle note de lecture sur le livre de Christophe Masutti intitulé Affaires privées. Aux sources du capitalisme de surveillance, (Caen, C&F éditions, mars 2020). En plus d’éclairer quelques facettes de notre présent numérique et panoptique, on y apprend quelques éléments sur la naissance de l’expression « Capitalisme de surveillance », très en vogue depuis la publication d’un livre éponyme de Shoshana Zuboff.
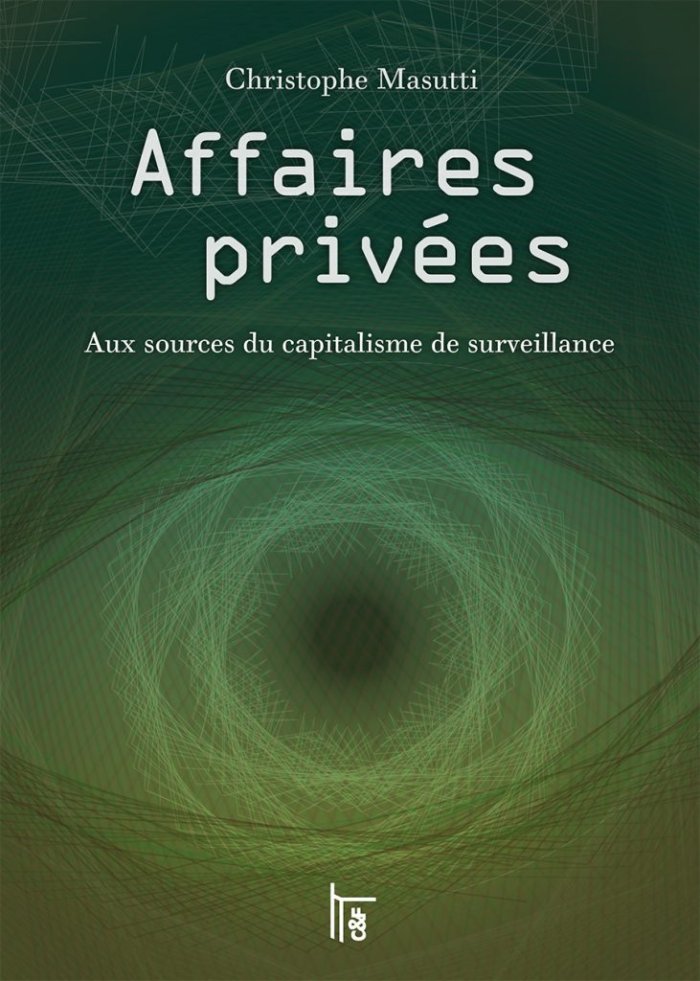
L’expression « capitalisme de surveillance » a été popularisée par la sociologue américaine Shoshana Zuboff, dont la notice Wikipédia nous dit qu’elle « a produit plusieurs concepts originaux », au premier rang desquels la même notice mentionne ce désormais fameux « capitalisme de surveillance ». En quoi Wikipédia se (et nous) trompe : en effet, Christophe Masuttinous apprend (du moins, il m’apprend) dès l’introduction d’Affaires privées, p. 27, que ce concept « est né sous les plumes de John B. Foster et Robert W. McChesney », en 2014, dans un article de la Monthly Review intitulé précisément « Surveillance Capitalism. Monopoly-Finance Capital, the Military-Industrial Complex, and the Digital Age ».Toujours selon Masutti, Shoshana Zuboff l’a repris dès 2015 lors d’une conférence, mais, poursuit-il, « [s]es lecteurs noteront que, dans ses articles, elle ne mentionne pas [cette] paternité du concept ». J’avoue que je n’ai pas lu les 864 pages de l’essai de Shoshana Zuboff, récemment traduit en français aux éditions Zulma (octobre 2020) : L’Âge du capitalisme de surveillance, (paru d’abord en allemand à Francfort en 2018, puis en anglais à New York en 2019). Mais le concert de louanges qui ont accueilli sa publication en France, aussi bien de la part de la presse que de celle des libraires, et dont le site de son éditeur [1] donne un aperçu, montre assez quelle version sera retenue de cette petite histoire : les extraits de presse publiés là mettent l’accent sur la nouveauté de cette analyse, sur son côté inédit : « Un de ces livres qui posent un jalon, un livre à partir duquel on peut discuter, un livre qui donne de notre monde une idée qu’on ne s’était pas exprimée aussi clairement jusque-là », dit Xavier de la Porte dans L’Obs. Un livre qui fera référence, est-il dit aussi. Ces appréciations en disent long sur la paresse intellectuelle de leurs auteurs, pour ne pas dire leur ignorance (ou, peut-être, leur peu d’estime) des travaux déjà publiés depuis un certain temps sur le sujet [2]. C’est ce que je crois comprendre, en tout cas, en lisant Masutti et quelques-unes des références qu’il donne dans sa bibliographie.
Il peut sembler superflu de s’arrêter à ce qui pourrait être interprété simplement comme une querelle d’ego entre intellectuels travaillant dans le même champ (et il y a peut-être de cela). Mais ce serait trop simple, justement. En fait, il semble que si Shoshana Zuboff ne fait pas référence à la thèse de Foster et McChesney, ce n’est pas seulement pour « usurper » l’invention d’un concept, mais bien plutôt parce qu’elle ne partage pas leur analyse. En effet, selon celle-ci, le capitalisme de surveillance est avant tout… le capitalisme. Voici ce qu’en disait la Monthly Review en juin 2018 :
« En 2015, Shoshana Zuboff, professeur émérite à la Harvard Business School, a repris le terme de “capitalisme de surveillance” (sans l’attribuer à Monthly Review), dans une analyse qui a suscité un intérêt considérable dans les milieux universitaires et qui est rapidement devenue l’acception prédominante du concept. Dans son discours, Zuboff a défini le capitalisme de surveillance de façon plus réductrice comme un système dans lequel la surveillance de la population est un procédé qui permet d’acquérir des informations qui peuvent ensuite être monétisées et vendues. L’objet de ses recherches était donc d’étudier les interrelations entre les entreprises et les comportements individuels dans ce nouveau système d’espionnage marchandisé. Mais un tel point de vue a en réalité dissocié le capitalisme de surveillance de l’analyse de classe et de la structure politico-économique globale du capitalisme – comme si la surveillance pouvait être abstraite du capital monopolistique financier dans son ensemble. De plus, elle a largement éludé la question de la relation symbiotique entre les entreprises militaires et privées – principalement en marketing, finance, haute technologie et contrats de défense – qui était au cœur de l’analyse de Foster et McChesney. » (p. 389)
Christophe Masutti, lui, ne partage pas entièrement ce point de vue, si je comprends bien. Il reconnaît à Zuboff le mérite d’une analyse qui met en évidence une « inflexion historique néfaste dans le capitalisme », un choix stratégique important qui infléchit sa trajectoire (plutôt vers le pire que vers le meilleur), là où Foster et McChesney voient« une certaine linéarité », donc plutôt une évolution sans véritable rupture (et, de même, dans le sens du pire plutôt que du meilleur). Cependant, la critique de Zuboff se limite à un « mauvais capitalisme » (le capitalisme de surveillance) qui viendrait menacer les institutions libérales de la démocratie de marché engendrée par le « bon capitalisme »… Masutti explique que cette limitation est due au fait que Zuboff ne s’intéresse pas à l’histoire du capitalisme, ni à celle des technologies (informatique, télécoms), des institutions, encore moins à celle de l’intrication des pratiques qui ont fini par aboutir au capitalisme de surveillance. Là réside précisément toute l’ambition de ce livre – comme l’annonce son sous-titre : « Aux sources du capitalisme de surveillance ».
Mais probablement suis-je entré un peu vite dans le vif du sujet. Il faudrait commencer par comprendre de quoi l’on parle lorsque que l’on utilise ce terme de surveillance. Il s’agit fondamentalement de processus d’enregistrement : « Notre quotidien est enregistré, mesuré, considéré comme une somme de procédures dont la surveillance consiste à transformer l’apparent chaos (et notre diversité) en ordre. » (p. 24) Voici qui me rappelle ce qu’écrit James C.Scott dans L’Œil de l’État [3] (je souligne) :« […]des processus aussi disparates que la création de patronymes permanents, la standardisation des unités de poids et de mesure, l’établissement de cadastres et de registres de population, l’invention de la propriété libre et perpétuelle, la standardisation de la langue et du discours juridique, l’aménagement des villes et l’organisation des réseaux de transports me sont apparus comme autant de tentatives d’accroître la lisibilité et la simplification. Dans chacun de ces cas, des agents de l’État se sont attaqués à des pratiques sociales locales d’une extrême complexité, quasiment illisibles, comme les coutumes d’occupation foncière ou d’attribution de noms propres, et ils ont créé des grilles de lecture standardisées à partir desquelles les pratiques pouvaient être consignées et contrôlées centralement. »
Scott parlait de l’État, tandis que les surveillance studies, qui se sont développées durant les dernières décennies, se sont intéressées aussi de près aux pratiques des acteurs économiques : « L’entreprise surveille ses employés aussi bien que ses clients. Tous systématisent la surveillance, créent de l’expertise et, finalement, l’intègrent dans des routines, des processus, qui font eux-mêmes également l’objet de surveillance. » (p. 24-25) Masutti poursuit : « Il faut reconnaître que les pratiques de surveillance modernes ont créé une nouvelle configuration de l’économie et de nos rapports sociaux. […] On déploie des moyens (souvent coûteux) de surveillance dès lors que celle-ci va permettre d’attribuer une valeur à l’information récoltée, en particulier une valeur décisionnelle. Ce rapport coût-bénéfice crée un marché.
« Ce marché est inclus dans un système capitaliste particulier. Il est caractérisé par un phénomène de concentration de l’information (devenue un capital privé et une ressource-propriété lucrative) et une concentration monopolistique des acteurs de l’économie de services numériques qui possèdent les technologies propres aux pratiques de la surveillance, attribuant leurs valeurs et leurs rentabilités aux informations. » (p. 25)
« […] l’informatisation de la société depuis les années 1960 a très rapidement conduit, ajoute Masutti (p. 27), à l’émergence d’une économie de la surveillance qui repose sur la valorisation des données. Dès le début de ce processus, la centralisation de l’information et les discours sur l’invasion de la vie privée sont concomitants de l’avènement d’un nouveau style de capitalisme, un capitalisme de surveillance. »
Concernant les efforts déployés par l’État afin de mettre en ordre le chaos social de sorte à le rendre lisible, contrôlable et corvéable à merci, Scott explique qu’il ne s’agissait pas seulement de recenser tout ce qui existait, puis de le classer, de le ranger en catégories, mais bien de lesimplifier, car la complexité du réel résistait à toute lisibilité. Il fallait donc éliminer tout ce qui ne rentrait pas dans des grilles de mesures standardisées. On pourrait dire, me semble-t-il, que les Gafam, comme il est désormais convenu de désigner les géants de l’économie numérique, ne font pas autre chose, employant cependant des outils autrement sophistiqués. En effet, il s’agit toujours de décomposer le réel en unités de mesures quantifiables et dès lors manipulables à merci. De leur point de vue, nous ne sommes plus rien d’autre que des amas de données qu’ils s’évertuent à extraire, accumuler, organiser, comparer, ré-agréger et au moyen desquelles ils finissent par produire des doubles numériques de nous-mêmes – non plus Big Brother, mais Big Other, comme l’a bien vu Shoshana Zuboff. « L’ennui, conclut Masutti, c’est que ces doubles deviennent des normes. » (p. 386)
Dans cette histoire de la standardisation du réel, je crois qu’il faudrait aussi évoquer l’une des raisons du succès de l’expansion de l’Occident dès les débuts du capitalisme : il y eut bien sûr les agents biologiques qui exterminèrent la plupart des populations du Nouveau Monde, mais il y eut aussi ce que, dans son maître ouvrage sur La Mesure de la réalité, Alfred W. Crosby, suivant les historiens français, appelle la « mentalité » :
« Au cours du Moyen Âge et de la Renaissance, un nouveau modèle de réalité a surgi en Europe. Un modèle quantitatif a commencé à remplacer l’ancien modèle qualitatif. Copernic et Galilée, les artisans qui apprenaient à fabriquer de bons canons avec régularité, les cartographes qui dessinaient les terres nouvellement abordées, les bureaucrates et les entrepreneurs qui dirigeaient leurs empires et les compagnies des Indes orientales et occidentales, les banquiers qui recueillaient et contrôlaient les flux de richesses nouvelles : tous ces gens concevaient la réalité en termes quantitatifs avec plus de cohérence que tous les autres membres de leur espèce [4]
Mais encore une fois, je vais trop vite en besogne– et je suis hors-sujet. Car l’intérêt d’Affaires privées, c’est aussi et surtout de se livrer à une « archéologie du capitalisme de surveillance » (c’est le titre de son introduction). Il retrace ainsi, comme le dit la quatrième de couverture,« l’histoire technique et culturelle de soixante années de controverses, de discours, de réalisations ou d’échecs ». À côté du développement des technologies et de l’industrie informatique, il nous montre comment, dans un premier temps (qui dure jusqu’à aujourd’hui) l’informatisation de la société a surtout été dénoncée comme l’avènement d’une dystopie orwellienne dans laquelle chacun·e allait être soumis·e au contrôle de l’État. Pendant ce temps, « la surveillance venue du monde des affaires [à travers le marketing] n’a longtemps suscité qu’indifférence. Le business des données en a profité pour bousculer les cadres juridiques et réglementaires de la vie privée. »
J’aimerais aussi signaler, entre autres, le chapitre particulièrement intéressant sur « Le cas français : dilution des institutions ». Il montre comment les Gafam ont, par l’intermédiaire du « pantouflage (allers-retours des hauts-fonctionnaires du service de l’État à celui de grandes firmes privées), colonisé l’administration française (un sous-titre éloquent de ce chapitre : « Microsoft à tous les étages » – cela concerne l’Éducation nationale) et offre un exemple concret de ce que Alain Deneault, dont je parlais ici-même récemment [5], nomme la « gouvernance », soit l’effacement de toute démocratie représentative derrière de nébuleux comités d’experts tous plus compétents les uns que les autres. Le livre ayant été publié en mars 2020, il ne pouvait faire référence à la manière dont Emmanuel Macron s’appuie désormais principalement sur ces fameux comités afin de décider en toute non-transparence ce qu’il convient de faire face à la pandémie de Covid-19. Mais je crois aussi qu’il y aurait tout un développement à faire sur la manière dont ces fumeux experts s’appuient sur des… données afin de déterminer des « stratégies sanitaires ». Foin de la clinique et des individus réels : on s’occupe désormais du (ou plutôt des, puisqu’il faut bien aussi qu’il existe des divergences de vue entre experts, n’est-ce pas ?) doubles numériques de populations entières. Arc-boutés sur leurs courbes statistiques (à lisser, bien sûr !), les épidémiologistes ont pris le pouvoir. Au point que l’on a pu interdire aux praticiens de prescrire certains médicaments, et même d’en parler publiquement ! Mais je m’égare une fois de plus.
Voilà donc un livre tout à fait utile, en ce qu’il montre bien comment s’est installée la dictature soft(pas toujours, d’ailleurs) de la Big data, comment elle n’est rien d’autre que la forme contemporaine du capitalisme et en même temps (comme dirait qui vous savez) comment elle modifie profondément nos manières de vivre et nos rapports sociaux. On aura compris que je le recommande chaudement.
franz himmelbauer
[2] Ok, j’exagère peut-être un peu, mais quand même. Outre le livre de Christophe Masutti (dont je rappelle qu’il date déjà de mars 2020, on pourrait citer quelques autres références parmi les très nombreuses qu’il cite lui-même, et en particulier les travaux d’Antoinette Rouvroy et Thomas Berns, entre autres :« Gouvernementalité algorithmique et perspectives d’émancipation »,Réseaux, 2013/1, n°177.
[3] Dont j’ai parlé ici :https://antiopees.noblogs.org/post/2021/01/
17/james-c-scott-loeil-de-letat-moderniser-uniformiser-detruire/
[4] Alfred W. Crosby,La Mesure de la réalité.Laquantification dans la société occidentale (1250-1600), traduit de l’anglais par Jean-Marc Mandosio, Paris, Éditions Allia, 2003. Extrait cité : Préface, p. 12.
