AVANT-PROPOS : les articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » ne représentent pas les positions de notre tendance, mais sont publiés à titre d’information ou pour nourrir les débats d’actualités.
SOURCE : Dissidences

Un compte rendu de Frédéric Thomas
Le terme de « pétroleuses », comme le rappelle la romancière et essayiste Édith Thomas (1909-1970) fut inventé au lendemain de l’écrasement de la Commune de Paris, fin mai 1871, pour qualifier les femmes qui auraient, à l’aide de pétrole, incendié divers édifices au cours de laSemaine sanglante. Ainsi, dans la Revue de France du 1er juillet 1871, P. Maigne parle d’« une légion de mégères, recrutées dans les bouges des arrondissements excentriques du nord et de l’est [de Paris]. Ce sont ces horribles créatures que l’indignation publique a flétries du nom de pétroleuses, nom maudit que l’histoire conservera pour la honte des hommes qui, pendant deux mois, ont terrorisé une population de plus de quinze cent mille âmes ». Mais l’auteure renverse l’insulte et attribue, dans ce livre, le titre de « pétroleuse » à « toutes les femmes qui ont été mêlées au mouvement révolutionnaire de 1871 : ce n’est nullement péjoratif » (p. 24).
Édith Thomas retrace de manière synthétique l’histoire de l’insurrection parisienne, pour se concentrer sur la situation des femmes, avant, pendant et après la Commune. Elle dresse un diagnostic de la condition féminine du prolétariat à la fin de l’Empire, marquée par l’union libre, l’exploitation et la pauvreté. « La prostitution apparaît donc comme un moyen normal, et souvent indispensable, de compléter le salaire, ou d’y suppléer quand il manque totalement » (p. 33). Elle revient également sur la pensée de Proudhon, qui dominait alors la pensée socialiste française, et qui se caractérisait par un positionnement particulièrement réactionnaire par rapport aux femmes, dont il prétendait démontrer la triple infériorité physique, intellectuelle et morale (p. 51 et suivantes). À l’encontre de telles prétentions, ici ou là, à la fin des années 1860, de rares voix de femmes commencent à se faire entendre. Telle celle de Maria Deraismes affirmant : « L’infériorité des femmes n’est pas un fait de la nature, c’est une invention humaine, c’est une fiction sociale » (p. 57).
La succession de la guerre franco-prussienne, du renversement de l’Empire, du siège de Paris, puis de la Commune sert de catalyseur à l’éducation politique (et à la radicalisation) du peuple, y compris les femmes. Celles-ci participent directement à la lutte en se faisant cantinières, ambulancières, interviennent dans des clubs – auxquels Édith Thomas consacre un chapitre, et qui jouèrent un rôle de débat et de réflexion collectif important –, en créent même. Les communards – de même, plus spécifiquement, comme le rappelle l’auteure, les chirurgiens et officiers qui se montrent hostiles envers les ambulancières – sont loin de reconnaître l’égalité entre les hommes et les femmes. Comme l’écrit ironiquement l’auteure : « les républicains sont plein d’inconséquence : ils ne veulent pas que les femmes soient sous l’emprise des prêtres, mais il leur déplaît qu’elles soient libres penseuses et qu’elles veuillent agir comme des êtres humains, égaux et libres » (p. 207). Mais certaines mesures qu’ils sont amenés à prendre, comme la remise des loyers, la suppression de la vente des objets déposés au Mont-de-Piété, dépassent leurs intentions, et affectent plus directement et plus positivement les femmes. Surtout, le projet de réforme d’enseignement, qui traduit non seulement un « effort de laïcisation et d’organisation de l’enseignement pour les jeunes filles », mais prévoit aussi « légalité des salaires entre les hommes et les femmes » (p. 177). Et, peut-être plus encore le décret du 10 avril, qui accorde « une pension de 600 francs (…) à la femme, mariée ou non, de tout garde national tué pour la défense des droits du peuple (…). Chacun de ses enfants, reconnu ou non, percevrait, jusqu’à l’âge de dix-huit ans, une pension ». Édith Thomas n’hésite pas à y voir « l’une des mesures les plus révolutionnaires » de la Commune, dans la mesure où elle reconnaît implicitement la structure de la famille ouvrière, caractérisée par l’union libre « en-dehors des cadres des lois religieuses et bourgeoises » (p. 102).
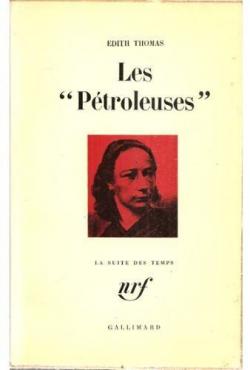
Couverture de l’édition originale du livre, en 1963, chez Gallimard.
L’auteure offre différents portraits émouvants et impressionnants de femmes (plus) connues – André Léo (1824-1900), au premier rang desquelles Louise Michel (1830-1905), dont Édith Thomas écrira ensuite la biographie, et dont elle rappelle l’insolence presque joyeuse et la bravoure à son procès, Élisabeth Dmitrieff (1851-1910 ou 1918) – ou non (et dont on suit leurs procès) – Nathalie Lemel (p. 150), Victorine Brocher, (mieux connue depuis peu grâce au beau roman graphique, les Damnés de la Commune de Raphaël Meyssan (2017-20191). Elle revient également sur diverses institutions, telle que l’Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés, organisée par une jeune révolutionnaire russe, Élisabeth Dmitrieff, amie de Marx et de ses filles, qu’elle avait, peu de temps auparavant, rencontré à Londres. Un chapitre est d’ailleurs consacré à cette Union, qui participe de la section française de l’Internationale, et qui ne représente qu’une frange des femmes impliquées dans la lutte.
Si des femmes ont effectivement participé aux incendies volontaires – une partie furent provoqués par les obus versaillais ; une autre fut employée comme tactique de défense par les communards ; une autre enfin, très certainement, visait les symboles du pouvoir, comme le feu mis aux Tuileries –, la figure des pétroleuses constitue un mythe, fruit d’une hystérie collective, dont même un auteur aussi hostile que Maxime Du Camp, dans ses Convulsions de Paris (1878-1880), fit justice. Cette figure renvoie plutôt aux fantasmes et aux peurs du patriarcat, dont on peut lire l’écho dans le réquisitoire du capitaine Jouenne évoquant « des créatures indignes qui semblent avoir pris à tâche de devenir l’opprobre de leur sexe et de répudier le rôle immense et magnifique de la femme dans la société » (cité p. 255). Or, c’est justement ce rôle – et avec celui-ci, la société dans laquelle il prenait place – que ces femmes entendaient bousculer sinon renverser.
Au bout du compte, que reste-t-il des « pétroleuses » ? Cette évidence : « des femmes, qui, coude à coude avec les fédérés, ont lutté pour la défense des barricades, ont relevé des blessés » (p. 264). Et Édith Thomas, en cherchant à se rapprocher au plus près, sous les masses et la sociologie des groupes, des visages singuliers de ces femmes, de terminer son essai en passant le relais au mythe poétique forgé par Hugo, Verlaine et Rimbaud2.
Originellement publié il y a plus d’un demi-siècle (en 1963), le livre date un peu bien sûr. Et, par certains côtés, il a vieilli. Depuis lors, et plus particulièrement au cours de ces dernières années, les études sur la Commune se sont multipliées et complexifiées. De même, pour ce qui est du féminisme. Les « pétroleuses » n’en demeure pas moins agréable à lire, pourvu d’une justesse et d’une empathie (d’autant plus remarquable pour l’époque) toujours actuelle. En ce sens, on ne peut que se féliciter que les éditions de L’Amourier3 aient pris l’initiative de rééditer ce livre, précédée d’une préface inédite de Bernard Noël, poète et auteur du Dictionnaire de la Commune(1871), avec, en couverture, un très beau dessin d’Ernest Pignon-Ernest. Ce livre « est le premier », écrit le préfacier, dont le rôle des femmes au cours de la Commune « est le sujet principal » (p. 8). Édith Thomas vint « logiquement » à la Commune de Paris à partir de son intérêt et ses essais sur les femmes en 1848 et George Sand. Mais elle évoque aussi furtivement sa grand-mère, et, dans l’introduction de l’ouvrage, son propre engagement dans la Résistance : « ce qui me permet peut-être de comprendre les femmes de la Commune, c’est d’avoir participé dans la Résistance au comité directeur de l’Union des Femmes Françaises, d’avoir rédigé leurs tracts, d’avoir préparé avec elles les manifestations des femmes contre le gouvernement de Vichy et l’occupant nazi ; les barricades de 1944 répondent aux barricades de 1871 » (p. 24).
Il y a dans cette réponse, comme un passage, une constellation pour reprendre l’image de Walter Benjamin, d’ailleurs évoqué dans la préface. Et Bernard Noël d’affirmer que certains événements, comme la Commune de Paris de 1871, détiennent « un pouvoir d’agitation qui n’en finit pas de relancer les passions » (p. 7).
1Voir la recension de ce roman graphique sur ce blog, https://dissidences.hypotheses.org/13120
2Se faisant cependant, elle donne une vision quelque peu erronée de la position de Victor Hugo : si celui-ci témoigna son empathie et même sa solidarité envers les communards vaincus, il ne fut jamais un partisan de la Commune, se plaçant au-dessus de la mêlée. Si cela suffit à le distinguer de l’écrasante majorité d’écrivains de l’époque, hostiles à la Commune, y compris Zola et Flaubert, il n’est pas possible pour autant d’aligner sa position sur celle de Paul Verlaine et d’Arthur Rimbaud, ayant, eux, pris fait et cause pour la Commune. D’ailleurs, un poème comme L’Homme juste (juillet 1871) tend ces dernières années à être interprété par les études rimbaldiennes comme une évocation (condamnation) du positionnement de Victor Hugo. Voir http://abardel.free.fr/petite_anthologie/l_homme_juste_panorama.htm#interpretations.
